Rme Père Bernard Laure (1873-1946), chanoine d'honneur
 Bernard-Albert Laure naît le 23 novembre 1873 à Tonneins (Lot-et-Garonne), de Louis Laure, tonnelier, et de Marie Galine, cigarière. Il entre jeune au monastère bénédictin Sainte-Marie-Madeleine de Marseille (de la congrégation de Solesmes) et y fait profession simple le 25 octobre 1894 et solennelle le 15 août 1898. Il est ordonné prêtre le 10 juin 1900 et conquiert un doctorat en philosophie. Il partagera l’errance de sa communauté obligée de prendre le chemin de l’exil sous le coup des lois anticléricales : le monastère se transporte en 1901 à San Remo (Ligurie), puis à Acquafredda (au sud du lac de Garde) et enfin à Chiari (à l’ouest de Brescia) en 1910. Là, un adolescent de Concesio (à une trentaine de kilomètres) fréquente assidûment l’abbaye et y voit naître sa vocation sacerdotale : aidé par le Père Hôtelier qui le dissuade d’entrer (« Monsieur l’abbé, vous avez une vocation d’apôtre, restez dans le clergé diocésain »), il rendra d’autres services à l’Eglise et deviendra le saint pape Paul VI. En 1919 Dom Laure est élu sous-prieur de la communauté. A la demande de Mgr Castellan, archevêque de Chambéry, et à la faveur de l’apaisement politique, les bénédictins de Sainte-Marie-Madeleine sont appelés à prendre le relai de l’abbaye cistercienne d'Hautecombe qui dépérissait, et peuvent rentrer en France en 1922. L’abbé, Dom Léon Guilloreau, meurt presque aussitôt, le 14 novembre 1922 et c’est Dom Bernard Laure qui est élu le 5 décembre suivant pour lui succéder, devenant de fait le premier abbé de la nouvelle fondation. Il reçoit la bénédiction abbatiale le 15 janvier 1923. Durant son abbatiat de vingt ans, l’abbaye est florissante : 31 professions sont célébrées entre 1923 et 1941 (dont celle de Marc Lacan, frère de Jacques Lacan…). Aimé de ses moines et apprécié de tous en Savoie, il reçoit le titre de chanoine d’honneur des églises de Chambéry, Fréjus, Annecy et Marseille ; il est en outre officier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare. C’est en 1929 que Mgr Simeone avait conféré le canonicat à Dom Laure qui avait honoré de sa présence la cérémonie de consécration des autels de la chartreuse de Montrieux qui venait de retrouver sa vocation primitive : ce 27 juin 1929 autour du cardinal Maurin, de NN. SS. Castellan, Simeone, Giray, on notait encore la présence de Mgr Béchetoille ou de Dom Léon, abbé de Frigolet, tous deux également devenus chanoines d’honneur cette année-là. En 1941, en raison de problèmes de santé, il résigne sa charge d'abbé d'Hautecombe et reste au sein de son monastère. Il y meurt le 14 janvier 1946.
Bernard-Albert Laure naît le 23 novembre 1873 à Tonneins (Lot-et-Garonne), de Louis Laure, tonnelier, et de Marie Galine, cigarière. Il entre jeune au monastère bénédictin Sainte-Marie-Madeleine de Marseille (de la congrégation de Solesmes) et y fait profession simple le 25 octobre 1894 et solennelle le 15 août 1898. Il est ordonné prêtre le 10 juin 1900 et conquiert un doctorat en philosophie. Il partagera l’errance de sa communauté obligée de prendre le chemin de l’exil sous le coup des lois anticléricales : le monastère se transporte en 1901 à San Remo (Ligurie), puis à Acquafredda (au sud du lac de Garde) et enfin à Chiari (à l’ouest de Brescia) en 1910. Là, un adolescent de Concesio (à une trentaine de kilomètres) fréquente assidûment l’abbaye et y voit naître sa vocation sacerdotale : aidé par le Père Hôtelier qui le dissuade d’entrer (« Monsieur l’abbé, vous avez une vocation d’apôtre, restez dans le clergé diocésain »), il rendra d’autres services à l’Eglise et deviendra le saint pape Paul VI. En 1919 Dom Laure est élu sous-prieur de la communauté. A la demande de Mgr Castellan, archevêque de Chambéry, et à la faveur de l’apaisement politique, les bénédictins de Sainte-Marie-Madeleine sont appelés à prendre le relai de l’abbaye cistercienne d'Hautecombe qui dépérissait, et peuvent rentrer en France en 1922. L’abbé, Dom Léon Guilloreau, meurt presque aussitôt, le 14 novembre 1922 et c’est Dom Bernard Laure qui est élu le 5 décembre suivant pour lui succéder, devenant de fait le premier abbé de la nouvelle fondation. Il reçoit la bénédiction abbatiale le 15 janvier 1923. Durant son abbatiat de vingt ans, l’abbaye est florissante : 31 professions sont célébrées entre 1923 et 1941 (dont celle de Marc Lacan, frère de Jacques Lacan…). Aimé de ses moines et apprécié de tous en Savoie, il reçoit le titre de chanoine d’honneur des églises de Chambéry, Fréjus, Annecy et Marseille ; il est en outre officier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare. C’est en 1929 que Mgr Simeone avait conféré le canonicat à Dom Laure qui avait honoré de sa présence la cérémonie de consécration des autels de la chartreuse de Montrieux qui venait de retrouver sa vocation primitive : ce 27 juin 1929 autour du cardinal Maurin, de NN. SS. Castellan, Simeone, Giray, on notait encore la présence de Mgr Béchetoille ou de Dom Léon, abbé de Frigolet, tous deux également devenus chanoines d’honneur cette année-là. En 1941, en raison de problèmes de santé, il résigne sa charge d'abbé d'Hautecombe et reste au sein de son monastère. Il y meurt le 14 janvier 1946.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.


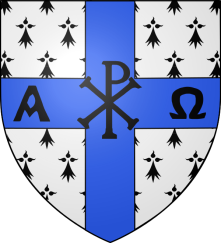 Guislain-Joseph Labouré naît le 27 octobre 1841 à Achiet-le-Petit (diocèse d’Arras). Il fait ses études au Petit-séminaire d’Arras de 1854 à 1861 puis au séminaire Saint-Sulpice, à Paris, de 1861 à 1864, où il est le condisciple d'Eudoxe-Irénée Mignot. Il est ordonné prêtre pour le diocèse d’Arras le 23 septembre 1865. Professeur puis directeur d'études et enfin, de 1872 à 1882, supérieur du Petit séminaire du diocèse, il est fait chanoine d'Arras et devient vicaire général de Mgr Meignan, au contact duquel il acquiert des conceptions de conciliation avec la République. Il est nommé évêque du Mans le 27 mars 1885 et sacré dans la cathédrale de Luçon le 31 mai suivant. A ce titre, il est le co-consécrateur de Mgr Oury, jusque-là prêtre du diocèse du Mans, qui lui donnera le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1889. Il assure dans son diocèse de vigoureuses visites pastorales, rétablit les missions paroissiales et les conférences ecclésiastiques. Après avoir refusé le siège d'Arras en 1891, Mgr Labouré accepte d'être promu archevêque de Rennes le 15 juin 1893. Léon XIII le crée cardinal-prêtre du titre de Santa-Maria Nuova le 19 avril 1897. Il participe au conclave de 1903 qui élit saint Pie X. Assurant que le christianisme est une "religion de paix dans la charité", il mène une politique d'apaisement en un temps d'opposition de plus en plus marquée entre la République et l'Eglise. Lors des inventaires de 1906, il préconise de laisser les portes des églises ouvertes, s'attirant de vives critiques de la part de la droite locale. Il meurt à Rennes le 21 avril 1906, à la suite de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui l’avait beaucoup affecté et dont il avait été l’un des négociateurs dans ses prémices.
Guislain-Joseph Labouré naît le 27 octobre 1841 à Achiet-le-Petit (diocèse d’Arras). Il fait ses études au Petit-séminaire d’Arras de 1854 à 1861 puis au séminaire Saint-Sulpice, à Paris, de 1861 à 1864, où il est le condisciple d'Eudoxe-Irénée Mignot. Il est ordonné prêtre pour le diocèse d’Arras le 23 septembre 1865. Professeur puis directeur d'études et enfin, de 1872 à 1882, supérieur du Petit séminaire du diocèse, il est fait chanoine d'Arras et devient vicaire général de Mgr Meignan, au contact duquel il acquiert des conceptions de conciliation avec la République. Il est nommé évêque du Mans le 27 mars 1885 et sacré dans la cathédrale de Luçon le 31 mai suivant. A ce titre, il est le co-consécrateur de Mgr Oury, jusque-là prêtre du diocèse du Mans, qui lui donnera le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1889. Il assure dans son diocèse de vigoureuses visites pastorales, rétablit les missions paroissiales et les conférences ecclésiastiques. Après avoir refusé le siège d'Arras en 1891, Mgr Labouré accepte d'être promu archevêque de Rennes le 15 juin 1893. Léon XIII le crée cardinal-prêtre du titre de Santa-Maria Nuova le 19 avril 1897. Il participe au conclave de 1903 qui élit saint Pie X. Assurant que le christianisme est une "religion de paix dans la charité", il mène une politique d'apaisement en un temps d'opposition de plus en plus marquée entre la République et l'Eglise. Lors des inventaires de 1906, il préconise de laisser les portes des églises ouvertes, s'attirant de vives critiques de la part de la droite locale. Il meurt à Rennes le 21 avril 1906, à la suite de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui l’avait beaucoup affecté et dont il avait été l’un des négociateurs dans ses prémices. D’une branche cadette des Grimaldi d’Antibes (son arrière-grand-père, Gaspard, est le petit-fils de Gaspard II et de sa seconde épouse), de la maison des princes de Monaco (il descend au 12ème degré de Rainier Ier, fondateur de la dynastie), Jean-Henry de Grimaldi est le très lointain cousin (au 18ème degré) de Mgr François-Honoré de Grimaldi, archevêque de Besançon de 1723 à 1732, et de façon plus proche de Mgr Jean-Charles de Grimaldi, évêque de Rodez de 1716 à 1733 (au 12ème degré), et de son neveu Mgr Louis-André de Grimaldi, évêque du Mans puis de Noyon, qui refusera de se démettre à l’occasion du concordat de 1801 et mourra en exil à Londres en 1804.
D’une branche cadette des Grimaldi d’Antibes (son arrière-grand-père, Gaspard, est le petit-fils de Gaspard II et de sa seconde épouse), de la maison des princes de Monaco (il descend au 12ème degré de Rainier Ier, fondateur de la dynastie), Jean-Henry de Grimaldi est le très lointain cousin (au 18ème degré) de Mgr François-Honoré de Grimaldi, archevêque de Besançon de 1723 à 1732, et de façon plus proche de Mgr Jean-Charles de Grimaldi, évêque de Rodez de 1716 à 1733 (au 12ème degré), et de son neveu Mgr Louis-André de Grimaldi, évêque du Mans puis de Noyon, qui refusera de se démettre à l’occasion du concordat de 1801 et mourra en exil à Londres en 1804. Raimond fut lui-même archidiacre de la cathédrale de Riez, au plus tard en 1304 ; et un diplôme de Charles II, du 11 juin 1305, ajoute à ce titre celui de clerc du comte de Provence : archidiaconi Regensis, clerici, familiaris et fidelis nostri. En 1308, il était devenu prévôt de l’église de Fréjus (un acte du 12 juin 1308 passé à Riez lui donne déjà ce titre), et il le restera jusqu’à sa nomination à l’évêché de Marseille, par bulles de Clément V en date du 1er janvier 1313. Il fut sacré sans doute à Avignon, par le cardinal Bérenger Frédol, évêque de Tusculum. Les comtes de Provence ne cessèrent pour autant de l’employer à leurs affaires : il est ainsi envoyé par Robert d'Anjou comme nonce au sujet du versement du cens dû par le roi de Naples à l'Eglise romaine, en 1310 et 1311; en 1312, il est procureur d'Enguerrand Stella, élu de Capoue et chancelier du roi. Le 12 septembre 1319, il est promu à l’archevêché d’Embrun. Il mourut dans le courant de l’année 1323.
Raimond fut lui-même archidiacre de la cathédrale de Riez, au plus tard en 1304 ; et un diplôme de Charles II, du 11 juin 1305, ajoute à ce titre celui de clerc du comte de Provence : archidiaconi Regensis, clerici, familiaris et fidelis nostri. En 1308, il était devenu prévôt de l’église de Fréjus (un acte du 12 juin 1308 passé à Riez lui donne déjà ce titre), et il le restera jusqu’à sa nomination à l’évêché de Marseille, par bulles de Clément V en date du 1er janvier 1313. Il fut sacré sans doute à Avignon, par le cardinal Bérenger Frédol, évêque de Tusculum. Les comtes de Provence ne cessèrent pour autant de l’employer à leurs affaires : il est ainsi envoyé par Robert d'Anjou comme nonce au sujet du versement du cens dû par le roi de Naples à l'Eglise romaine, en 1310 et 1311; en 1312, il est procureur d'Enguerrand Stella, élu de Capoue et chancelier du roi. Le 12 septembre 1319, il est promu à l’archevêché d’Embrun. Il mourut dans le courant de l’année 1323. Le 16 décembre 1874 nait à Caluire Emmanuel-Ernest-Marie Béchetoille, fils de Victor (1840-1910), négociant, et de Suzanne Mondon (1847-1938). Son père, qui s’était installé dans l’agglomération lyonnaise, était né à Annonay ; il était issu d’une lignée annonéenne de marchands-drapiers devenus banquiers : son père Jean-Antoine-André (1809-1842) était fils de Jean-Antoine-Marie (1779-1823), fils de Jean-Antoine (1746-1811), fils de Jean-Baptiste (1719-1787), fils de Claude (1694-1707), fils d’André (1649-1707), fils de Gabriel (1611-1686), fils de Louis (1583-1611), fils de Michel (1560-1583), fils de Jacques. L’abbé Béchetoille, ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon, y exercera de hautes fonctions :
Le 16 décembre 1874 nait à Caluire Emmanuel-Ernest-Marie Béchetoille, fils de Victor (1840-1910), négociant, et de Suzanne Mondon (1847-1938). Son père, qui s’était installé dans l’agglomération lyonnaise, était né à Annonay ; il était issu d’une lignée annonéenne de marchands-drapiers devenus banquiers : son père Jean-Antoine-André (1809-1842) était fils de Jean-Antoine-Marie (1779-1823), fils de Jean-Antoine (1746-1811), fils de Jean-Baptiste (1719-1787), fils de Claude (1694-1707), fils d’André (1649-1707), fils de Gabriel (1611-1686), fils de Louis (1583-1611), fils de Michel (1560-1583), fils de Jacques. L’abbé Béchetoille, ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon, y exercera de hautes fonctions : 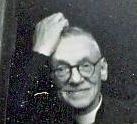 président du Conseil de l’Œuvre pontificale de la Propagation de la foi, chanoine puis doyen du chapitre de Lyon, protonotaire apostolique, chancelier puis vicaire général. Il meurt à Lyon (5ème) le 31 janvier 1964. Il avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Simeone en 1929 ; le 27 juin de cette année-là, il participait à la cérémonie de consécration des autels de la chartreuse de Montrieux qui venait de retrouver sa vocation primitive : autour du cardinal Maurin, de NN. SS. Castellan, Simeone et Giray, on notait encore la présence de Dom Laure, abbé d'Hautecombe et de Dom Léon, abbé de Frigolet, tous deux devenus aussi chanoines d’honneur cette année. Le 8 décembre 1930, c'est Monseigneur Béchetoille qui, au nom du cardinal Maurin, archevêque de Lyon, chantait la messe de la dédicace au cours de laquelle Monseigneur Simeone consacrait la chapelle du séminaire de La Castille.
président du Conseil de l’Œuvre pontificale de la Propagation de la foi, chanoine puis doyen du chapitre de Lyon, protonotaire apostolique, chancelier puis vicaire général. Il meurt à Lyon (5ème) le 31 janvier 1964. Il avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Simeone en 1929 ; le 27 juin de cette année-là, il participait à la cérémonie de consécration des autels de la chartreuse de Montrieux qui venait de retrouver sa vocation primitive : autour du cardinal Maurin, de NN. SS. Castellan, Simeone et Giray, on notait encore la présence de Dom Laure, abbé d'Hautecombe et de Dom Léon, abbé de Frigolet, tous deux devenus aussi chanoines d’honneur cette année. Le 8 décembre 1930, c'est Monseigneur Béchetoille qui, au nom du cardinal Maurin, archevêque de Lyon, chantait la messe de la dédicace au cours de laquelle Monseigneur Simeone consacrait la chapelle du séminaire de La Castille.