Jean-Claude Pitometz (1940-2023)
 Jean-Claude Pitometz naît au Luc le 13 avril 1940 dans une famille nombreuse. Son père meurt très tôt, des suites de la guerre et sa mère doit faire face seule à la charge de la famille dont sortiront deux prêtres : Noël, né en 1935 et Jean-Claude qui est ordonné prêtre au Luc le 8 avril 1967 par Mgr Barthe, pour lequel il conservera toujours une grande dévotion. Après les premières années de vicariat à Brue-Auriac puis à Saint-Maximin où il a découvert notamment auprès de l’abbé André Augier l'Institut séculier des Prêtres du Cœur de Jésus dont il sera membre à son tour, l’abbé Jean-Claude Pitometz est nommé curé de Fayence en 1979, puis des Arcs-sur-Argens de 1988 à 1992, et enfin de Cavalaire et du Rayol-Canadel : il y arrivera en juillet 1992 et y demeurera jusqu’en août 2010.
Jean-Claude Pitometz naît au Luc le 13 avril 1940 dans une famille nombreuse. Son père meurt très tôt, des suites de la guerre et sa mère doit faire face seule à la charge de la famille dont sortiront deux prêtres : Noël, né en 1935 et Jean-Claude qui est ordonné prêtre au Luc le 8 avril 1967 par Mgr Barthe, pour lequel il conservera toujours une grande dévotion. Après les premières années de vicariat à Brue-Auriac puis à Saint-Maximin où il a découvert notamment auprès de l’abbé André Augier l'Institut séculier des Prêtres du Cœur de Jésus dont il sera membre à son tour, l’abbé Jean-Claude Pitometz est nommé curé de Fayence en 1979, puis des Arcs-sur-Argens de 1988 à 1992, et enfin de Cavalaire et du Rayol-Canadel : il y arrivera en juillet 1992 et y demeurera jusqu’en août 2010.
Figure atypique, il ne laissait personne insensible. Vrai provençal, motard chevronné, pompier volontaire, il aimait parcourir le monde pour aider son prochain. Il avait accompagné plusieurs fois les sapeurs-pompiers du département du Var pour des missions humanitaires en Afrique où pendant quatre ans il avait servi comme missionnaire au Congo entre 1975 et 1979. C’était un personnage haut en couleurs, qui n’avait pas hésité à descendre en rappel le clocher de son église pour une association !
L’abbé Pitometz est nommé chanoine honoraire et installé le 22 septembre 2006. Retiré au Luc, il meurt à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon le 4 mars 2023.
Ses obsèques sont célébrées le 8 mars 2023 en l’église du Luc présidées par Mgr Ravotti entouré d’une quinzaine de prêtres et d’une foule très nombreuse dans laquelle des personnes de tous horizons, image de l’homme de proximité, et particulièrement avec les plus petits, que fut le chanoine Pitometz.
On lira ci-après l’homélie que donna alors Monseigneur Jean-Pierre Ravotti.
Obsèques du P. Jean-Claude Pitometz,
Chanoine honoraire du diocèse de Fréjus-Toulon
Le Luc. 8 mars 2023
 Le carême que nous venons de commencer oriente nos cœurs vers le mystère pascal de Jésus crucifié, mort et ressuscité. Le baptême nous a plongés dans ce mystère de mort et de vie, de mort qui donne la vie. Le P. Jean-Claude Pitometz, par les souffrances de cette ultime période de sa vie et par sa mort, a accompli ce passage pascal. Nous le remettons avec confiance entre les mains de son Créateur et de son Sauveur, pour que, purifié de tout péché, l’ombre de la mort se transforme pour lui en aurore de lumière et de vie éternelle, dans la louange sans fin du royaume des cieux.
Le carême que nous venons de commencer oriente nos cœurs vers le mystère pascal de Jésus crucifié, mort et ressuscité. Le baptême nous a plongés dans ce mystère de mort et de vie, de mort qui donne la vie. Le P. Jean-Claude Pitometz, par les souffrances de cette ultime période de sa vie et par sa mort, a accompli ce passage pascal. Nous le remettons avec confiance entre les mains de son Créateur et de son Sauveur, pour que, purifié de tout péché, l’ombre de la mort se transforme pour lui en aurore de lumière et de vie éternelle, dans la louange sans fin du royaume des cieux.
Les liens qui m’unissaient à Jean-Claude n’étaient pas seulement d’amitié, mais de vraie fraternité sacerdotale. Ces liens, nous les devions à l’un de mes frères, Franco, qui était son ami. Mais ils se renforcèrent surtout, je pense, après la mort de notre ami commun, le P. Michel Moncault, avec qui Jean-Claude avait passé ses premières années de sacerdoce, d’abord à Brue-Auriac, puis à Saint-Maximin, sous la houlette discrète et bienveillante du P André Augier. Peu à peu, se sont ainsi resserrés des liens que rien ne laissait prévoir au départ, car nous étions et sommes restés très différents : moi, plutôt traditionnel dans ma façon de concevoir le sacerdoce, conception que je n’ai d’ailleurs jamais reniée ; lui, plutôt frondeur… Pourtant, une grande confiance s’est instaurée entre nous, devenant une véritable fraternité sacerdotale. Il m’invita ainsi, plusieurs années de suite, à venir prêcher la fête de l’Assomption à Cavalaire, où il était curé, visiblement heureux (me disait-il), que nous puissions fêter ensemble la Sainte Vierge Marie pour laquelle il nourrissait une profonde et virile affection. Ce fut dans ces circonstances que je lui remis d’ailleurs la croix de chanoine honoraire du diocèse, chose à laquelle il n’avait pas attaché une grande importance, mais qui fit la joie de ses paroissiens. C’est lui aussi qui m’incita à prêcher en provençal – cette langue du terroir qu’il aimait parce qu’elle le rapprochait des simples gens dont il se sentait solidaire. Ainsi, bien des fois, nous avons célébré ensemble la Saint-Louis à Brignoles, la Saint-Marcel à Barjols, la Sainte-Madeleine à Hyères, et même la Saint-Domnin dans une petite paroisse du diocèse de Digne…
Et puis, insensiblement, il me fit son confident, son conseiller, jusqu’à son confesseur, choix qui ne manqua pas de me surprendre, mais comment lui refuser ce service fraternel ? Lorsqu’il débarquait chez nous, à Saint-Maximin, souvent les mains pleines, l’air était à la fête. Il parlait, il chantait, nous livrant ses souvenirs et remuant volontiers le passé. Des noms de personnes ou de lieux revenaient sans cesse, et certains sont restés gravés dans ma mémoire : son père trop tôt disparu, des conséquences de la guerre ; sa sainte maman, qui éleva sa famille au prix de grands sacrifices et vit fleurir deux vocations : celle de Noël et de notre Jean-Claude ; son village du Luc et son curé Chabaud, surnommé Lou Gibous, car il était bossu ; et encore Mgr Gilles Barthe, l’évêque du diocèse, ou encore le cardinal Biayenda, qu’il avait connu au Congo Brazzaville et dont il était devenu l’ami ; mais aussi bien sûr, Michel Moncault, les pères André Augier et Louis Porte, le chanoine Antonin Barberis et l’abbé Vincent Ferrer, sans oublier l’équipe de foot de Saint-Maximin et les pompiers de Tanneron, et d’innombrables amis. Le soir, avant le repos, nous disions ensemble les complies. Il nous est même arrivé d’en chanter une partie en latin, qu’il entonnait lui-même, souvenance de ses années de séminaire.
Personnellement, je considère cette amitié sacerdotale comme une grâce et une leçon de vie, dont je voudrais, ce soir, remercier Jean-Claude. Nul besoin d’avoir les mêmes idées, de faire les mêmes choix ou de partager la même sensibilité, pour se découvrir et être vraiment frères et amis dans l’unique sacerdoce du seul Grand Prêtre, le Christ. Lui même, Jésus, la veille de sa mort, fait une confidence bouleversante à ses disciples. Ces paroles du maître, nous venons de les entendre dans l’Evangile, et il est significatif qu’elles forment une des antiennes du rite d’ordination des prêtres :
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn XV 15)
Certes, c’est déjà très beau d’être les serviteurs du Seigneur – dans l’Eglise, on donne ce titre aux futurs béatifiés ou canonisés –, mais c’est une grâce bien plus grande encore d’être considérés comme ses amis. « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ».
Cette amitié, que Jésus offre à ses prêtres pour qu’ils la partagent et en vivent, est le fondement de notre fraternité sacerdotale. Avant d’être des confrères – au moins dans le sens que l’on donne habituellement à ce mot –, nous devrions être des amis, car le lien sacramentel qui nous unit à l’évêque et nous lie les uns aux autres est infiniment plus fort et plus signifiant que tout ce qui pourrait nous diviser.
Voyez, à ce sujet, ce que nous rappelle le concile Vatican II dans le décret Presbyterorum ordinis sur le ministère et la vie des prêtres :
« Du fait de leur ordination, qui les fait entrer dans l’ordre du presbytérat, les prêtres sont tous intimement liés entre eux par la fraternité sacramentelle. » Et plus loin : « chaque prêtre est donc uni à ses confrères par un lien de charité, de prière et de coopération sous diverses formes : ainsi se manifeste l’unité parfaite que le Christ a voulu établir entre les siens, afin que le monde croie que le Fils a été envoyé par le Père » (n.8).
Ah, si ces paroles empreintes de justesse théologique et de sagesse, pouvaient devenir réalité !
Cher Jean-Claude, merci de m’avoir rappelé cet enseignement de l’Eglise par le témoignage de ta confiance et de ton amitié. Avec Noël et tous les tiens, avec Dominique qui a veillé sur toi jusqu’au bout, avec Franco qui a accouru à ton chevet et t’a fait prier dans les dernières heures de ta vie, avec tes frères prêtres et tous tes amis, nous te confions maintenant à l’éternelle miséricorde du Seigneur, dans la consolante certitude que « rien, désormais, ne pourra te séparer de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm VIII 39), ainsi qu’en témoigne l’Apôtre. Tout le reste, y compris nos lubies, a si peu d’importance…
Que la Très Sainte Vierge Marie, mère du Souverain Prêtre et de tous les prêtres, intercède pour toi et veille sur nous tous qui sommes ses enfants.
Ainsi soit-il.
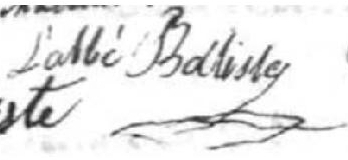 Le jeune promu n’atteindra les 21 ans qu’en 1792. C’est à cette date que l’ « abbé » Louis Baliste apparait encore comme simple ecclésiastique au baptême de sa filleule Louise Clérian le 13 juillet de cette année, en l’église du Luc. Mais la Révolution avait depuis anéanti le chapitre et sans doute aussi les espérances du ci-devant capiscol qui ne parviendra visiblement pas au sacerdoce : il meurt en effet dans la maison paternelle du Luc le 21 floréal an II, soit le 10 mai 1794 à seulement 23 ans…
Le jeune promu n’atteindra les 21 ans qu’en 1792. C’est à cette date que l’ « abbé » Louis Baliste apparait encore comme simple ecclésiastique au baptême de sa filleule Louise Clérian le 13 juillet de cette année, en l’église du Luc. Mais la Révolution avait depuis anéanti le chapitre et sans doute aussi les espérances du ci-devant capiscol qui ne parviendra visiblement pas au sacerdoce : il meurt en effet dans la maison paternelle du Luc le 21 floréal an II, soit le 10 mai 1794 à seulement 23 ans…

 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

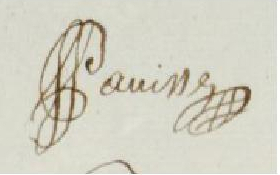 Panisse, chef de l’Etat Major de la 25ème division militaire, jure le 5 octobre 1813 d’être fidèle à l’empereur et promet de se dévouer à son service. Passé au service du roi, il est fait officier de la Légion d’honneur le 27 janvier 1815, il est alors adjudant commandant, chef de l’Etat major de la 6ème division militaire. Le 24 septembre 1816, le colonel Panisse, chef d’Etat major jure, cette fois, d’être fidèle au roi. Dix ans plus tard, il meurt à Paris, rue Neuve des Capucines, le 24 novembre 1826, laissant curieusement héritière sa belle-sœur, la baronne de Fressinet.
Panisse, chef de l’Etat Major de la 25ème division militaire, jure le 5 octobre 1813 d’être fidèle à l’empereur et promet de se dévouer à son service. Passé au service du roi, il est fait officier de la Légion d’honneur le 27 janvier 1815, il est alors adjudant commandant, chef de l’Etat major de la 6ème division militaire. Le 24 septembre 1816, le colonel Panisse, chef d’Etat major jure, cette fois, d’être fidèle au roi. Dix ans plus tard, il meurt à Paris, rue Neuve des Capucines, le 24 novembre 1826, laissant curieusement héritière sa belle-sœur, la baronne de Fressinet. Bertrand de Boniface (14 -1543)
Bertrand de Boniface (14 -1543)
 L’abbé Corbin devint alors curé du Luc-en-Provence, de 1997 à 2000, et enfin de Flayosc de 2000 à 2012. C’est en 2006 qu’il fut nommé chanoine honoraire du chapitre cathédral de Toulon et installé le 22 septembre de cette année, pour honorer son esprit de service et sa qualité de relation. Il prit sa retraite en 2012 et s’installa à Draguignan où il se mit naturellement à la disposition de la paroisse. Mais l’âge et les infirmités rendirent bientôt nécessaire son placement à l’Ehpad de la Pierre de la fée, bien qu’il eût préféré se retirer à la Castille où ses souvenirs le ramenaient mais dont la maison de retraite du clergé n’existait malheureusement plus. Il y meurt le 6 mars 2023. Ses obsèques furent célébrées le mardi 14 mars en l’église Saint-Michel de Draguignan et il fut ensuite inhumé à Fayence dans le caveau familial.
L’abbé Corbin devint alors curé du Luc-en-Provence, de 1997 à 2000, et enfin de Flayosc de 2000 à 2012. C’est en 2006 qu’il fut nommé chanoine honoraire du chapitre cathédral de Toulon et installé le 22 septembre de cette année, pour honorer son esprit de service et sa qualité de relation. Il prit sa retraite en 2012 et s’installa à Draguignan où il se mit naturellement à la disposition de la paroisse. Mais l’âge et les infirmités rendirent bientôt nécessaire son placement à l’Ehpad de la Pierre de la fée, bien qu’il eût préféré se retirer à la Castille où ses souvenirs le ramenaient mais dont la maison de retraite du clergé n’existait malheureusement plus. Il y meurt le 6 mars 2023. Ses obsèques furent célébrées le mardi 14 mars en l’église Saint-Michel de Draguignan et il fut ensuite inhumé à Fayence dans le caveau familial. Jean-Claude Pitometz naît au Luc le 13 avril 1940 dans une famille nombreuse. Son père meurt très tôt, des suites de la guerre et sa mère doit faire face seule à la charge de la famille dont sortiront deux prêtres : Noël, né en 1935 et Jean-Claude qui est ordonné prêtre au Luc le 8 avril 1967 par Mgr Barthe, pour lequel il conservera toujours une grande dévotion. Après les premières années de vicariat à Brue-Auriac puis à Saint-Maximin où il a découvert notamment auprès de l’abbé André Augier l'Institut séculier des Prêtres du Cœur de Jésus dont il sera membre à son tour, l’abbé Jean-Claude Pitometz est nommé curé de Fayence en 1979, puis des Arcs-sur-Argens de 1988 à 1992, et enfin de Cavalaire et du Rayol-Canadel : il y arrivera en juillet 1992 et y demeurera jusqu’en août 2010.
Jean-Claude Pitometz naît au Luc le 13 avril 1940 dans une famille nombreuse. Son père meurt très tôt, des suites de la guerre et sa mère doit faire face seule à la charge de la famille dont sortiront deux prêtres : Noël, né en 1935 et Jean-Claude qui est ordonné prêtre au Luc le 8 avril 1967 par Mgr Barthe, pour lequel il conservera toujours une grande dévotion. Après les premières années de vicariat à Brue-Auriac puis à Saint-Maximin où il a découvert notamment auprès de l’abbé André Augier l'Institut séculier des Prêtres du Cœur de Jésus dont il sera membre à son tour, l’abbé Jean-Claude Pitometz est nommé curé de Fayence en 1979, puis des Arcs-sur-Argens de 1988 à 1992, et enfin de Cavalaire et du Rayol-Canadel : il y arrivera en juillet 1992 et y demeurera jusqu’en août 2010. Le carême que nous venons de commencer oriente nos cœurs vers le mystère pascal de Jésus crucifié, mort et ressuscité. Le baptême nous a plongés dans ce mystère de mort et de vie, de mort qui donne la vie. Le P. Jean-Claude Pitometz, par les souffrances de cette ultime période de sa vie et par sa mort, a accompli ce passage pascal. Nous le remettons avec confiance entre les mains de son Créateur et de son Sauveur, pour que, purifié de tout péché, l’ombre de la mort se transforme pour lui en aurore de lumière et de vie éternelle, dans la louange sans fin du royaume des cieux.
Le carême que nous venons de commencer oriente nos cœurs vers le mystère pascal de Jésus crucifié, mort et ressuscité. Le baptême nous a plongés dans ce mystère de mort et de vie, de mort qui donne la vie. Le P. Jean-Claude Pitometz, par les souffrances de cette ultime période de sa vie et par sa mort, a accompli ce passage pascal. Nous le remettons avec confiance entre les mains de son Créateur et de son Sauveur, pour que, purifié de tout péché, l’ombre de la mort se transforme pour lui en aurore de lumière et de vie éternelle, dans la louange sans fin du royaume des cieux.