Pierre Isnard (1809-1898)
Pierre nait le 16 septembre 1809 à Cagnes, fils de Pascal Isnard (1761-1829), cultivateur propriétaire, et de Marguerite Trastour. Il est ordonné sous-diacre le 23 mars 1833 et prêtre, le 21 décembre 1833. D’abord recteur à La Martre, le jeune prêtre fut envoyé en 1836 comme professeur au Petit séminaire de Grasse. Après six ans d’enseignement, l’abbé Isnard devient vicaire à Vence le 15 août 1842, puis est nommé professeur de nouveau (il enseigne le dogme) et directeur au Grand séminaire de Fréjus le 1er août 1844. Il retrouve le ministère paroissial comme recteur de la Colle le 5 mars 1848 et enfin comme vicaire à Grasse le 13 octobre 1853. Monseigneur le distingue en lui donnant le camail de chanoine honoraire le 9 février 1872 (son curé est alors le chanoine Pierre Mistre) et ce sera son successeur, Mgr Terris, qui l’appellera à Fréjus le 1er août 1883 pour occuper une stalle de chanoine titulaire dans sa cathédrale. Le chanoine Pierre Isnard était vraiment un prêtre selon le cœur de Dieu, d’une piété et d’une régularité exemplaires, d’une rare modestie, tout et toujours à son devoir. Partout, mais surtout à Grasse où son zèle s’exerça plus longtemps, il vit naître autour de lui des sympathies et des affections qui jamais ne se trahirent. Malheureusement, les dernières années à Fréjus furent assombries par la maladie et les infirmités qu’il supporta avec beaucoup de résignation à la volonté de Dieu, édifiant son entourage par sa piété et sa patience. Bientôt, les facultés intellectuelles elles-mêmes furent atteintes et la mort vint enfin mettre un terme à ses souffrances, à Fréjus le 11 août 1898.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

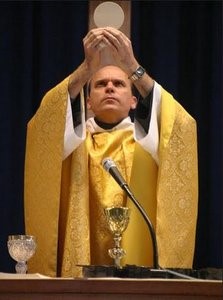 Dominique Marc Alain nait le 30 mai 1958 à Rouen, fils de Jean et de Bernadette Buisset, famille profondément chrétienne de Crécy-la-Chapelle ayant déjà donné plusieurs vocations religieuses et dont les enfants se sont tous d’une façon ou d’une autre engagés au service du Seigneur, notamment deux sœurs consacrées. Marqué par l’Arche de Jean Vannier où il passe quelques années, Dominique entre en 1980 à Fribourg dans la communauté Saint-Jean. En France il participe à la fondation des maisons de Rimont et de Saint-Jodard. Il fait profession en 1982 et reçoit alors le nom d’Etienne-Marie, il participe à la naissance du prieuré de la Chaise-Dieu en 1984 et reçoit l’ordination sacerdotale en 1985. Il exerce ensuite son ministère presbytéral dans le diocèse de Beauvais notamment à Attichy de 1986 à 1991. De 1991 à 1995, le Père Etienne-Marie est maître des novices à Saint-Jodard où il marque nombre de frères. Il revient ensuite à la Chaise-Dieu comme prieur jusqu’en 2001, année où il est envoyé en Belgique, comme prieur de Banneux. C’est en 2006 qu’il rejoint le diocèse de Fréjus-Toulon où lui est confiée la cure de Brignoles ; il est en outre nommé vicaire épiscopal pour la vie consacrée, et reçu chanoine honoraire le 25 novembre 2010. Il quitte ensuite le diocèse pour devenir prieur de la maison de Troussures, toujours dans l’Oise, de 2012 à 2014. Atteint depuis de longues années par la maladie de Charcot, il se retire dans sa famille à Faverolles, dans l’Aisne, en 2019 et meurt le 2 juillet 2020 à Compiègne. Ses funérailles ont lieu le 6 juillet dans la cathédrale de Soissons, présidées par Mgr Renauld de Dinechin. Il est inhumé au cimetière de Crécy-la-Chapelle.
Dominique Marc Alain nait le 30 mai 1958 à Rouen, fils de Jean et de Bernadette Buisset, famille profondément chrétienne de Crécy-la-Chapelle ayant déjà donné plusieurs vocations religieuses et dont les enfants se sont tous d’une façon ou d’une autre engagés au service du Seigneur, notamment deux sœurs consacrées. Marqué par l’Arche de Jean Vannier où il passe quelques années, Dominique entre en 1980 à Fribourg dans la communauté Saint-Jean. En France il participe à la fondation des maisons de Rimont et de Saint-Jodard. Il fait profession en 1982 et reçoit alors le nom d’Etienne-Marie, il participe à la naissance du prieuré de la Chaise-Dieu en 1984 et reçoit l’ordination sacerdotale en 1985. Il exerce ensuite son ministère presbytéral dans le diocèse de Beauvais notamment à Attichy de 1986 à 1991. De 1991 à 1995, le Père Etienne-Marie est maître des novices à Saint-Jodard où il marque nombre de frères. Il revient ensuite à la Chaise-Dieu comme prieur jusqu’en 2001, année où il est envoyé en Belgique, comme prieur de Banneux. C’est en 2006 qu’il rejoint le diocèse de Fréjus-Toulon où lui est confiée la cure de Brignoles ; il est en outre nommé vicaire épiscopal pour la vie consacrée, et reçu chanoine honoraire le 25 novembre 2010. Il quitte ensuite le diocèse pour devenir prieur de la maison de Troussures, toujours dans l’Oise, de 2012 à 2014. Atteint depuis de longues années par la maladie de Charcot, il se retire dans sa famille à Faverolles, dans l’Aisne, en 2019 et meurt le 2 juillet 2020 à Compiègne. Ses funérailles ont lieu le 6 juillet dans la cathédrale de Soissons, présidées par Mgr Renauld de Dinechin. Il est inhumé au cimetière de Crécy-la-Chapelle.