Pierre-Véran Marin (1800-1867)
 Pierre-Véran Marin naît à Cavaillon le 25 nivôse an VIII (15 janvier 1800), fils de Pierre Honoré Marin, propriétaire, et de Catherine Blanchet. En 1804, la famille vient s’installer à Salernes où l’enfant, sous la conduite d’une mère fort stricte, manifeste très vite à travers une profonde piété et une inclination vers les pauvres, une attirance pour la vie sacerdotale. L’abbé Romain Mossy, curé de Salernes (l’abbé Mossy allait mourir le 12 mai 1824 aux pieds de Mgr Richery, alors qu’il allait au devant du prélat venu visiter sa paroisse, entouré de ses ouailles), enseigna à son enfant de chœur les rudiments de latin et lui apprit à dompter une nature impétueuse. En 1809, Pierre-Véran fut admis au modeste pensionnat de l’abbé Issaurat, à Villecroze, où il fit sa première communion. En 1813, sur les conseils de l’abbé Mossy, il entra au Petit séminaire d’Aix dirigé par le vénérable chanoine Abel et où, à quatorze ans, il revêtit l’habit ecclésiastique qu’il ne quitterait plus. Après trois années, l’été 1816 lui permit de revoir ses parents, sa sœur et ses deux frères, avant de gagner le Grand séminaire d’Aix. Dans l’attente de l’âge requis pour être ordonné, Pierre-Véran Marin enseigna trois ans au collège de Draguignan. Enfin vint le moment des ordinations, conférées par Mgr de Richery : au sous-diaconat le 18 décembre 1824, au diaconat le 13 mars 1825 puis au sacerdoce le 28 mai 1825. Recommandé par ses formateurs, l’abbé Marin avait déjà été désigné pour enseigner la philosophie et assumer la responsabilité de directeur spirituel au Grand séminaire que l’évêque venait de rétablir à Fréjus. En juillet 1826, il découvrit Rome pour la première fois (il y retournera en 1858 et en 1867). La mort du chanoine Saurin en décembre de la même année lui abandonne la chaire d’Ecriture Sainte. En juillet 1828, l’abbé Marin était nommé vicaire à la paroisse Saint-Louis de Toulon où il exerça un ministère fructueux, mais il rêvait de partir évangéliser d’autres horizons, ce que son évêque, Mgr Michel, ne lui permit pas. Tout au plus lui concéda-t-il que, restant dans le diocèse, il puisse se consacrer exclusivement à la prédication. Alors que sa renommée l’avait fait appeler à prêcher le carême 1836 à Saint-Roch, à Paris, le choléra se déclara dans la ville de Toulon et l’abbé Marin considéra de son devoir de manquer à son honorable engagement plutôt qu’à la charité. Il resta et se donna tout entier et de manière héroïque au service des forçats tant à Toulon qu’à Saint-Mandrier où on les avait éloignés. Autre saint Jean-de-Dieu ou nouveau saint Vincent-de-Paul, l’abbé Marin mérita les éloges de la presse et la croix de la Légion d’honneur que Louis-Philippe voulut lui accorder à la demande du préfet-amiral, mais l’abbé la refusa catégoriquement : « J'ai celle de mon Sauveur Jésus, elle me suffit. Qu'on la donne à un pauvre marin, père de famille, elle lui sera plus utile qu'à moi. Je n'ai voulu travailler que pour le ciel, si j'acceptais une récompense j'aurais perdu mon temps. » A l’amiral de Martineng qui lui remit alors une médaille d’or envoyée par le roi avec quelques honoraires, il répondit : « Amiral, je ne vends pas ma vie, je la donne. » Aux multiples prédications qui le conduisaient parfois hors du diocèse, l’abbé Marin ajoutaient bien d’autres initiatives : à Toulon, il établit à la demande d’officiers de marine un cycle de conférences qui sera l’ébauche des Conférences Saint-Vincent-de-Paul. Il entra au service de la Marine le 15 janvier 1838. L’aumônerie du bagne étant devenue vacante par la mort de l’abbé Allemani cette année-là, l’abbé Marin qui s’y était déjà assuré la sympathie de tous la sollicita pour lui. Pendant dix-sept ans, il allait y mettre en œuvre son esprit inventif au service de l’évangélisation et recueillir des fruits inattendus. Mgr Michel tint à lui manifester son estime en lui adressant des lettres de chanoine honoraire de sa cathédrale le 15 mars 1841. La même année, le 10 juillet, le chanoine Marin fondait le couvent du Bon-Pasteur à Toulon, destiné à accueillir les filles repenties. Cette création sollicita tous ses efforts : il y consacra désormais son temps et sa fortune. Pour sa nouvelle famille, il n’hésita pas à prendre son bâton de pèlerin et se faire mendiant dans les villes et villages de Provence. En mars 1845, quatre mille ouvriers de l’arsenal se mettent en grève sur la base de revendications salariales, un bataillon d’infanterie de marine dépêché sur place ne les impressionne pas, les appels relayés par la presse le 3 mars, la proclamation du vice-amiral, les instances du baron de Beurmann, maire de la ville, le 5, la proclamation du sous-préfet, le 7, rien n’y fait. Le samedi 8, le chanoine Marin, armé de son chapelet et de sa confiance en Dieu se présente à eux avec l’aval de l’amiral-préfet, le soir même une délégation était reçue à la préfecture, le travail reprenait dès le lundi 10. Le 26 avril, le roi nommait le chanoine Marin chevalier de la Légion d’honneur. Cette fois, il l’accepta pour les 250 francs de rente dont allaient pouvoir bénéficier ses filles du Bon-Pasteur. Le 9 novembre 1846, Mgr Wicart qui aurait bien voulu en faire son vicaire général, crée pour lui le titre de doyen des aumôniers de la marine pour faire de lui son délégué à cette aumônerie. Le 26 janvier 1850, il donna l'extrême onction à un bagnard, Louis Bonafous, en religion Frère Léotade (Frère de la doctrine chrétienne, de Toulouse) qui, accusé à tort du meurtre d'une jeune fille, avait été envoyé au bagne deux ans plus tôt, faisant figure de martyr de la justice partiale de ce temps. En 1852, le chanoine Marin est élu à l’unanimité des voix par les électeurs de Salernes pour les représenter au Conseil général où il siégea également à la commission de l’agriculture et de l’instruction publique. Il se démit l’année suivante de ces fonctions. En 1853, il remit son ministère au bagne entre les mains des Pères Maristes et prit pour lui l’aumônerie de la flotte. Par décret du 29 octobre 1864, sur le rapport du ministre de la Marine et à la recommandation de l’amiral-préfet, le comte Bouët-Willaumez, le chanoine Marin fut élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur : avec la rosette, une pension de 500 francs à vie lui apportait de nouveaux moyens pour son œuvre du Bon-Pasteur. Il mourut à Toulon le 27 octobre 1867, entouré de la vénération de toute la population. Après des funérailles solennelles à la cathédrale de Toulon, il fut inhumé le 11 novembre dans la chapelle du Bon Pasteur où se lit son épitaphe :
Pierre-Véran Marin naît à Cavaillon le 25 nivôse an VIII (15 janvier 1800), fils de Pierre Honoré Marin, propriétaire, et de Catherine Blanchet. En 1804, la famille vient s’installer à Salernes où l’enfant, sous la conduite d’une mère fort stricte, manifeste très vite à travers une profonde piété et une inclination vers les pauvres, une attirance pour la vie sacerdotale. L’abbé Romain Mossy, curé de Salernes (l’abbé Mossy allait mourir le 12 mai 1824 aux pieds de Mgr Richery, alors qu’il allait au devant du prélat venu visiter sa paroisse, entouré de ses ouailles), enseigna à son enfant de chœur les rudiments de latin et lui apprit à dompter une nature impétueuse. En 1809, Pierre-Véran fut admis au modeste pensionnat de l’abbé Issaurat, à Villecroze, où il fit sa première communion. En 1813, sur les conseils de l’abbé Mossy, il entra au Petit séminaire d’Aix dirigé par le vénérable chanoine Abel et où, à quatorze ans, il revêtit l’habit ecclésiastique qu’il ne quitterait plus. Après trois années, l’été 1816 lui permit de revoir ses parents, sa sœur et ses deux frères, avant de gagner le Grand séminaire d’Aix. Dans l’attente de l’âge requis pour être ordonné, Pierre-Véran Marin enseigna trois ans au collège de Draguignan. Enfin vint le moment des ordinations, conférées par Mgr de Richery : au sous-diaconat le 18 décembre 1824, au diaconat le 13 mars 1825 puis au sacerdoce le 28 mai 1825. Recommandé par ses formateurs, l’abbé Marin avait déjà été désigné pour enseigner la philosophie et assumer la responsabilité de directeur spirituel au Grand séminaire que l’évêque venait de rétablir à Fréjus. En juillet 1826, il découvrit Rome pour la première fois (il y retournera en 1858 et en 1867). La mort du chanoine Saurin en décembre de la même année lui abandonne la chaire d’Ecriture Sainte. En juillet 1828, l’abbé Marin était nommé vicaire à la paroisse Saint-Louis de Toulon où il exerça un ministère fructueux, mais il rêvait de partir évangéliser d’autres horizons, ce que son évêque, Mgr Michel, ne lui permit pas. Tout au plus lui concéda-t-il que, restant dans le diocèse, il puisse se consacrer exclusivement à la prédication. Alors que sa renommée l’avait fait appeler à prêcher le carême 1836 à Saint-Roch, à Paris, le choléra se déclara dans la ville de Toulon et l’abbé Marin considéra de son devoir de manquer à son honorable engagement plutôt qu’à la charité. Il resta et se donna tout entier et de manière héroïque au service des forçats tant à Toulon qu’à Saint-Mandrier où on les avait éloignés. Autre saint Jean-de-Dieu ou nouveau saint Vincent-de-Paul, l’abbé Marin mérita les éloges de la presse et la croix de la Légion d’honneur que Louis-Philippe voulut lui accorder à la demande du préfet-amiral, mais l’abbé la refusa catégoriquement : « J'ai celle de mon Sauveur Jésus, elle me suffit. Qu'on la donne à un pauvre marin, père de famille, elle lui sera plus utile qu'à moi. Je n'ai voulu travailler que pour le ciel, si j'acceptais une récompense j'aurais perdu mon temps. » A l’amiral de Martineng qui lui remit alors une médaille d’or envoyée par le roi avec quelques honoraires, il répondit : « Amiral, je ne vends pas ma vie, je la donne. » Aux multiples prédications qui le conduisaient parfois hors du diocèse, l’abbé Marin ajoutaient bien d’autres initiatives : à Toulon, il établit à la demande d’officiers de marine un cycle de conférences qui sera l’ébauche des Conférences Saint-Vincent-de-Paul. Il entra au service de la Marine le 15 janvier 1838. L’aumônerie du bagne étant devenue vacante par la mort de l’abbé Allemani cette année-là, l’abbé Marin qui s’y était déjà assuré la sympathie de tous la sollicita pour lui. Pendant dix-sept ans, il allait y mettre en œuvre son esprit inventif au service de l’évangélisation et recueillir des fruits inattendus. Mgr Michel tint à lui manifester son estime en lui adressant des lettres de chanoine honoraire de sa cathédrale le 15 mars 1841. La même année, le 10 juillet, le chanoine Marin fondait le couvent du Bon-Pasteur à Toulon, destiné à accueillir les filles repenties. Cette création sollicita tous ses efforts : il y consacra désormais son temps et sa fortune. Pour sa nouvelle famille, il n’hésita pas à prendre son bâton de pèlerin et se faire mendiant dans les villes et villages de Provence. En mars 1845, quatre mille ouvriers de l’arsenal se mettent en grève sur la base de revendications salariales, un bataillon d’infanterie de marine dépêché sur place ne les impressionne pas, les appels relayés par la presse le 3 mars, la proclamation du vice-amiral, les instances du baron de Beurmann, maire de la ville, le 5, la proclamation du sous-préfet, le 7, rien n’y fait. Le samedi 8, le chanoine Marin, armé de son chapelet et de sa confiance en Dieu se présente à eux avec l’aval de l’amiral-préfet, le soir même une délégation était reçue à la préfecture, le travail reprenait dès le lundi 10. Le 26 avril, le roi nommait le chanoine Marin chevalier de la Légion d’honneur. Cette fois, il l’accepta pour les 250 francs de rente dont allaient pouvoir bénéficier ses filles du Bon-Pasteur. Le 9 novembre 1846, Mgr Wicart qui aurait bien voulu en faire son vicaire général, crée pour lui le titre de doyen des aumôniers de la marine pour faire de lui son délégué à cette aumônerie. Le 26 janvier 1850, il donna l'extrême onction à un bagnard, Louis Bonafous, en religion Frère Léotade (Frère de la doctrine chrétienne, de Toulouse) qui, accusé à tort du meurtre d'une jeune fille, avait été envoyé au bagne deux ans plus tôt, faisant figure de martyr de la justice partiale de ce temps. En 1852, le chanoine Marin est élu à l’unanimité des voix par les électeurs de Salernes pour les représenter au Conseil général où il siégea également à la commission de l’agriculture et de l’instruction publique. Il se démit l’année suivante de ces fonctions. En 1853, il remit son ministère au bagne entre les mains des Pères Maristes et prit pour lui l’aumônerie de la flotte. Par décret du 29 octobre 1864, sur le rapport du ministre de la Marine et à la recommandation de l’amiral-préfet, le comte Bouët-Willaumez, le chanoine Marin fut élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur : avec la rosette, une pension de 500 francs à vie lui apportait de nouveaux moyens pour son œuvre du Bon-Pasteur. Il mourut à Toulon le 27 octobre 1867, entouré de la vénération de toute la population. Après des funérailles solennelles à la cathédrale de Toulon, il fut inhumé le 11 novembre dans la chapelle du Bon Pasteur où se lit son épitaphe :
HIC. DOMI. EXPECT. PETR. VERA. MARIN.
ECCLI. FOROI. CANONI. ELEEMOS. DECA. NAVAL
NAT. CABELLIO. OB. TOLO. V K. NOV. A. MDCCCLXVII
AET. SV. LXVII
SACERD. SEC. COR. DEI. ANIMAR. ZELAT. DOMUS.
BONI. PASTORIS. FVNDATOR.
VALE. PATER. FIDES. ET. AMOR. Xt0. TE. SOCIANT
PRAESENS. FACILIVS. QVOD. POSTVLAS. IMPETRABIS
PIAE. FILIAE. MONVM. HOC. POSV. CUM. LACRI. BENEMEREN
NON. MORIAR. SED. VIVAM.
Ici attend le Seigneur Jésus, Pierre-Véran Marin,
Chanoine de l'Église de Fréjus, Aumônier doyen de la marine,
Né à Cavaillon, mort à Toulon, le cinq des calendes de novembre,
de l'an 1867, âgé de 67 ans.
Prêtre selon le cœur de Dieu, zélateur des âmes,
Fondateur de cette maison du Bon-Pasteur.
Adieu, Père, la foi et l'amour vous associent à Jésus-Christ
et maintenant que vous lui êtes présent, vous obtiendrez
plus facilement ce que vous lui demanderez pour nous.
Ses pieuses filles lui ont érigé ce monument avec leurs larmes
Il l'avait bien mérité !
Elles y ont fait graver son cri d'espérance :
Je ne mourrai pas, je vivrai !
 s Adrets. De là, il assuma successivement la charge de recteur de la Londe (1er janvier 1844), Néoules (15 janvier 1850), Seillans (1er novembre 1856), La Verdière (24 août 1865). C’est là qu’il acheva la rédaction et la publication d’une Vie de saint Louis, évêque de Toulouse et patron de Brignoles, éditée à Brignoles en 1876. L’abbé Hermitte fut enfin nommé recteur de Pourrières le 1er mai 1878. C’est en 1884, qu’il reçut de Mgr Terris le camail de chanoine honoraire. Il fut encore honoré du titre de camérier du pape Léon XIII. Ce bon et digne prêtre, membre du Tiers-Ordre de saint François, affilié au Saint-Sépulcre, avocat de Saint-Pierre, qui fut un bienfaiteur du séminaire et de toutes les œuvres diocésaines, mourut à Pourrières le 5 décembre 1887. Mgr Hermitte fut inhumé selon sa volonté à Brignoles, plus précisément sous la dalle du socle de l’autel dédié à son saint patron Louis d’Anjou, qu’il avait offert à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, avec cette condition. Le lendemain de ses funérailles, conformément à sa volonté furent distribués aux pauvres de la ville des bons de pain et de viande.
s Adrets. De là, il assuma successivement la charge de recteur de la Londe (1er janvier 1844), Néoules (15 janvier 1850), Seillans (1er novembre 1856), La Verdière (24 août 1865). C’est là qu’il acheva la rédaction et la publication d’une Vie de saint Louis, évêque de Toulouse et patron de Brignoles, éditée à Brignoles en 1876. L’abbé Hermitte fut enfin nommé recteur de Pourrières le 1er mai 1878. C’est en 1884, qu’il reçut de Mgr Terris le camail de chanoine honoraire. Il fut encore honoré du titre de camérier du pape Léon XIII. Ce bon et digne prêtre, membre du Tiers-Ordre de saint François, affilié au Saint-Sépulcre, avocat de Saint-Pierre, qui fut un bienfaiteur du séminaire et de toutes les œuvres diocésaines, mourut à Pourrières le 5 décembre 1887. Mgr Hermitte fut inhumé selon sa volonté à Brignoles, plus précisément sous la dalle du socle de l’autel dédié à son saint patron Louis d’Anjou, qu’il avait offert à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, avec cette condition. Le lendemain de ses funérailles, conformément à sa volonté furent distribués aux pauvres de la ville des bons de pain et de viande.

 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

 Pierre-Véran Marin naît à Cavaillon le 25 nivôse an VIII (15 janvier 1800), fils de Pierre Honoré Marin, propriétaire, et de Catherine Blanchet. En 1804, la famille vient s’installer à Salernes où l’enfant, sous la conduite d’une mère fort stricte, manifeste très vite à travers une profonde piété et une inclination vers les pauvres, une attirance pour la vie sacerdotale. L’abbé Romain Mossy, curé de Salernes (l’abbé Mossy allait mourir le 12 mai 1824 aux pieds de Mgr Richery, alors qu’il allait au devant du prélat venu visiter sa paroisse, entouré de ses ouailles), enseigna à son enfant de chœur les rudiments de latin et lui apprit à dompter une nature impétueuse. En 1809, Pierre-Véran fut admis au modeste pensionnat de l’abbé Issaurat, à Villecroze, où il fit sa première communion. En 1813, sur les conseils de l’abbé Mossy, il entra au Petit séminaire d’Aix dirigé par le vénérable chanoine Abel et où, à quatorze ans, il revêtit l’habit ecclésiastique qu’il ne quitterait plus. Après trois années, l’été 1816 lui permit de revoir ses parents, sa sœur et ses deux frères, avant de gagner le Grand séminaire d’Aix. Dans l’attente de l’âge requis pour être ordonné, Pierre-Véran Marin enseigna trois ans au collège de Draguignan. Enfin vint le moment des ordinations, conférées par Mgr de Richery : au sous-diaconat le 18 décembre 1824, au diaconat le 13 mars 1825 puis au sacerdoce le 28 mai 1825. Recommandé par ses formateurs, l’abbé Marin avait déjà été désigné pour enseigner la philosophie et assumer la responsabilité de directeur spirituel au Grand séminaire que l’évêque venait de rétablir à Fréjus. En juillet 1826, il découvrit Rome pour la première fois (il y retournera en 1858 et en 1867). La mort du chanoine Saurin en décembre de la même année lui abandonne la chaire d’Ecriture Sainte. En juillet 1828, l’abbé Marin était nommé vicaire à la paroisse Saint-Louis de Toulon où il exerça un ministère fructueux, mais il rêvait de partir évangéliser d’autres horizons, ce que son évêque, Mgr Michel, ne lui permit pas. Tout au plus lui concéda-t-il que, restant dans le diocèse, il puisse se consacrer exclusivement à la prédication. Alors que sa renommée l’avait fait appeler à prêcher le carême 1836 à Saint-Roch, à Paris, le choléra se déclara dans la ville de Toulon et l’abbé Marin considéra de son devoir de manquer à son honorable engagement plutôt qu’à la charité. Il resta et se donna tout entier et de manière héroïque au service des forçats tant à Toulon qu’à Saint-Mandrier où on les avait éloignés. Autre saint Jean-de-Dieu ou nouveau saint Vincent-de-Paul, l’abbé Marin mérita les éloges de la presse et la croix de la Légion d’honneur que Louis-Philippe voulut lui accorder à la demande du préfet-amiral, mais l’abbé la refusa catégoriquement : « J'ai celle de mon Sauveur Jésus, elle me suffit. Qu'on la donne à un pauvre marin, père de famille, elle lui sera plus utile qu'à moi. Je n'ai voulu travailler que pour le ciel, si j'acceptais une récompense j'aurais perdu mon temps. » A l’amiral de Martineng qui lui remit alors une médaille d’or envoyée par le roi avec quelques honoraires, il répondit : « Amiral, je ne vends pas ma vie, je la donne. » Aux multiples prédications qui le conduisaient parfois hors du diocèse, l’abbé Marin ajoutaient bien d’autres initiatives : à Toulon, il établit à la demande d’officiers de marine un cycle de conférences qui sera l’ébauche des Conférences Saint-Vincent-de-Paul. Il entra au service de la Marine le 15 janvier 1838. L’aumônerie du bagne étant devenue vacante par la mort de l’abbé Allemani cette année-là, l’abbé Marin qui s’y était déjà assuré la sympathie de tous la sollicita pour lui. Pendant dix-sept ans, il allait y mettre en œuvre son esprit inventif au service de l’évangélisation et recueillir des fruits inattendus. Mgr Michel tint à lui manifester son estime en lui adressant des lettres de chanoine honoraire de sa cathédrale le 15 mars 1841. La même année, le 10 juillet, le chanoine Marin fondait le couvent du Bon-Pasteur à Toulon, destiné à accueillir les filles repenties. Cette création sollicita tous ses efforts : il y consacra désormais son temps et sa fortune. Pour sa nouvelle famille, il n’hésita pas à prendre son bâton de pèlerin et se faire mendiant dans les villes et villages de Provence. En mars 1845, quatre mille ouvriers de l’arsenal se mettent en grève sur la base de revendications salariales, un bataillon d’infanterie de marine dépêché sur place ne les impressionne pas, les appels relayés par la presse le 3 mars, la proclamation du vice-amiral, les instances du baron de Beurmann, maire de la ville, le 5, la proclamation du sous-préfet, le 7, rien n’y fait. Le samedi 8, le chanoine Marin, armé de son chapelet et de sa confiance en Dieu se présente à eux avec l’aval de l’amiral-préfet, le soir même une délégation était reçue à la préfecture, le travail reprenait dès le lundi 10. Le 26 avril, le roi nommait le chanoine Marin chevalier de la Légion d’honneur. Cette fois, il l’accepta pour les 250 francs de rente dont allaient pouvoir bénéficier ses filles du Bon-Pasteur. Le 9 novembre 1846, Mgr Wicart qui aurait bien voulu en faire son vicaire général, crée pour lui le titre de doyen des aumôniers de la marine pour faire de lui son délégué à cette aumônerie. Le 26 janvier 1850, il donna l'extrême onction à un bagnard, Louis Bonafous, en religion Frère Léotade (Frère de la doctrine chrétienne, de Toulouse) qui, accusé à tort du meurtre d'une jeune fille, avait été envoyé au bagne deux ans plus tôt, faisant figure de martyr de la justice partiale de ce temps. En 1852, le chanoine Marin est élu à l’unanimité des voix par les électeurs de Salernes pour les représenter au Conseil général où il siégea également à la commission de l’agriculture et de l’instruction publique. Il se démit l’année suivante de ces fonctions. En 1853, il remit son ministère au bagne entre les mains des Pères Maristes et prit pour lui l’aumônerie de la flotte. Par décret du 29 octobre 1864, sur le rapport du ministre de la Marine et à la recommandation de l’amiral-préfet, le comte Bouët-Willaumez, le chanoine Marin fut élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur : avec la rosette, une pension de 500 francs à vie lui apportait de nouveaux moyens pour son œuvre du Bon-Pasteur. Il mourut à Toulon le 27 octobre 1867, entouré de la vénération de toute la population. Après des funérailles solennelles à la cathédrale de Toulon, il fut inhumé le 11 novembre dans la chapelle du Bon Pasteur où se lit son épitaphe :
Pierre-Véran Marin naît à Cavaillon le 25 nivôse an VIII (15 janvier 1800), fils de Pierre Honoré Marin, propriétaire, et de Catherine Blanchet. En 1804, la famille vient s’installer à Salernes où l’enfant, sous la conduite d’une mère fort stricte, manifeste très vite à travers une profonde piété et une inclination vers les pauvres, une attirance pour la vie sacerdotale. L’abbé Romain Mossy, curé de Salernes (l’abbé Mossy allait mourir le 12 mai 1824 aux pieds de Mgr Richery, alors qu’il allait au devant du prélat venu visiter sa paroisse, entouré de ses ouailles), enseigna à son enfant de chœur les rudiments de latin et lui apprit à dompter une nature impétueuse. En 1809, Pierre-Véran fut admis au modeste pensionnat de l’abbé Issaurat, à Villecroze, où il fit sa première communion. En 1813, sur les conseils de l’abbé Mossy, il entra au Petit séminaire d’Aix dirigé par le vénérable chanoine Abel et où, à quatorze ans, il revêtit l’habit ecclésiastique qu’il ne quitterait plus. Après trois années, l’été 1816 lui permit de revoir ses parents, sa sœur et ses deux frères, avant de gagner le Grand séminaire d’Aix. Dans l’attente de l’âge requis pour être ordonné, Pierre-Véran Marin enseigna trois ans au collège de Draguignan. Enfin vint le moment des ordinations, conférées par Mgr de Richery : au sous-diaconat le 18 décembre 1824, au diaconat le 13 mars 1825 puis au sacerdoce le 28 mai 1825. Recommandé par ses formateurs, l’abbé Marin avait déjà été désigné pour enseigner la philosophie et assumer la responsabilité de directeur spirituel au Grand séminaire que l’évêque venait de rétablir à Fréjus. En juillet 1826, il découvrit Rome pour la première fois (il y retournera en 1858 et en 1867). La mort du chanoine Saurin en décembre de la même année lui abandonne la chaire d’Ecriture Sainte. En juillet 1828, l’abbé Marin était nommé vicaire à la paroisse Saint-Louis de Toulon où il exerça un ministère fructueux, mais il rêvait de partir évangéliser d’autres horizons, ce que son évêque, Mgr Michel, ne lui permit pas. Tout au plus lui concéda-t-il que, restant dans le diocèse, il puisse se consacrer exclusivement à la prédication. Alors que sa renommée l’avait fait appeler à prêcher le carême 1836 à Saint-Roch, à Paris, le choléra se déclara dans la ville de Toulon et l’abbé Marin considéra de son devoir de manquer à son honorable engagement plutôt qu’à la charité. Il resta et se donna tout entier et de manière héroïque au service des forçats tant à Toulon qu’à Saint-Mandrier où on les avait éloignés. Autre saint Jean-de-Dieu ou nouveau saint Vincent-de-Paul, l’abbé Marin mérita les éloges de la presse et la croix de la Légion d’honneur que Louis-Philippe voulut lui accorder à la demande du préfet-amiral, mais l’abbé la refusa catégoriquement : « J'ai celle de mon Sauveur Jésus, elle me suffit. Qu'on la donne à un pauvre marin, père de famille, elle lui sera plus utile qu'à moi. Je n'ai voulu travailler que pour le ciel, si j'acceptais une récompense j'aurais perdu mon temps. » A l’amiral de Martineng qui lui remit alors une médaille d’or envoyée par le roi avec quelques honoraires, il répondit : « Amiral, je ne vends pas ma vie, je la donne. » Aux multiples prédications qui le conduisaient parfois hors du diocèse, l’abbé Marin ajoutaient bien d’autres initiatives : à Toulon, il établit à la demande d’officiers de marine un cycle de conférences qui sera l’ébauche des Conférences Saint-Vincent-de-Paul. Il entra au service de la Marine le 15 janvier 1838. L’aumônerie du bagne étant devenue vacante par la mort de l’abbé Allemani cette année-là, l’abbé Marin qui s’y était déjà assuré la sympathie de tous la sollicita pour lui. Pendant dix-sept ans, il allait y mettre en œuvre son esprit inventif au service de l’évangélisation et recueillir des fruits inattendus. Mgr Michel tint à lui manifester son estime en lui adressant des lettres de chanoine honoraire de sa cathédrale le 15 mars 1841. La même année, le 10 juillet, le chanoine Marin fondait le couvent du Bon-Pasteur à Toulon, destiné à accueillir les filles repenties. Cette création sollicita tous ses efforts : il y consacra désormais son temps et sa fortune. Pour sa nouvelle famille, il n’hésita pas à prendre son bâton de pèlerin et se faire mendiant dans les villes et villages de Provence. En mars 1845, quatre mille ouvriers de l’arsenal se mettent en grève sur la base de revendications salariales, un bataillon d’infanterie de marine dépêché sur place ne les impressionne pas, les appels relayés par la presse le 3 mars, la proclamation du vice-amiral, les instances du baron de Beurmann, maire de la ville, le 5, la proclamation du sous-préfet, le 7, rien n’y fait. Le samedi 8, le chanoine Marin, armé de son chapelet et de sa confiance en Dieu se présente à eux avec l’aval de l’amiral-préfet, le soir même une délégation était reçue à la préfecture, le travail reprenait dès le lundi 10. Le 26 avril, le roi nommait le chanoine Marin chevalier de la Légion d’honneur. Cette fois, il l’accepta pour les 250 francs de rente dont allaient pouvoir bénéficier ses filles du Bon-Pasteur. Le 9 novembre 1846, Mgr Wicart qui aurait bien voulu en faire son vicaire général, crée pour lui le titre de doyen des aumôniers de la marine pour faire de lui son délégué à cette aumônerie. Le 26 janvier 1850, il donna l'extrême onction à un bagnard, Louis Bonafous, en religion Frère Léotade (Frère de la doctrine chrétienne, de Toulouse) qui, accusé à tort du meurtre d'une jeune fille, avait été envoyé au bagne deux ans plus tôt, faisant figure de martyr de la justice partiale de ce temps. En 1852, le chanoine Marin est élu à l’unanimité des voix par les électeurs de Salernes pour les représenter au Conseil général où il siégea également à la commission de l’agriculture et de l’instruction publique. Il se démit l’année suivante de ces fonctions. En 1853, il remit son ministère au bagne entre les mains des Pères Maristes et prit pour lui l’aumônerie de la flotte. Par décret du 29 octobre 1864, sur le rapport du ministre de la Marine et à la recommandation de l’amiral-préfet, le comte Bouët-Willaumez, le chanoine Marin fut élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur : avec la rosette, une pension de 500 francs à vie lui apportait de nouveaux moyens pour son œuvre du Bon-Pasteur. Il mourut à Toulon le 27 octobre 1867, entouré de la vénération de toute la population. Après des funérailles solennelles à la cathédrale de Toulon, il fut inhumé le 11 novembre dans la chapelle du Bon Pasteur où se lit son épitaphe :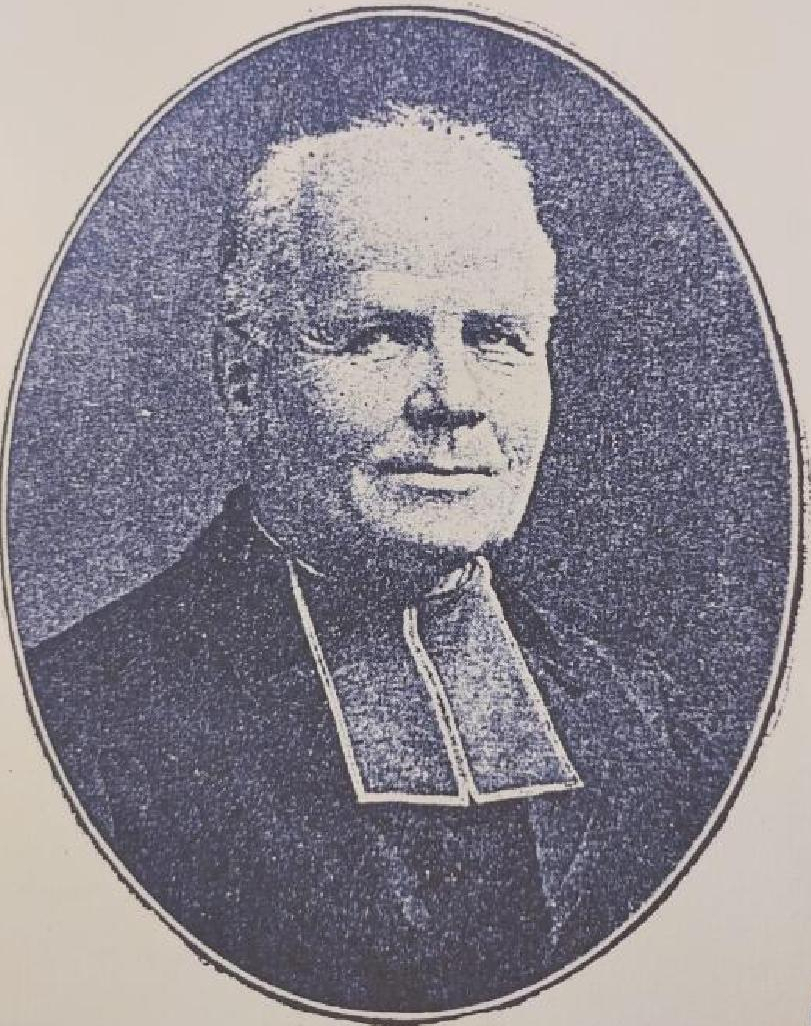 jeune Jules reçoit de sa famille les valeurs de travail et d’honorabilité qui s’y transmettaient de génération en génération. Après des études primaires et secondaires au collège de sa ville natale, il entre en 1867 au Grand Séminaire pour en sortir prêtre en 1872. Commence alors pour lui une très longue carrière qui le verra successivement vicaire à Trets, curé de Villeneuve-Gageron, professeur au collège catholique d’Aix, curé d’Alleins, Mallemort et de Saint-Pierre de Trinquetaille. L’importante paroisse de Salon ayant perdu son curé en décembre 1906, l’abbé Berlandier y fut nommé à 60 ans, en 1907, assumant une succession écrasante. Il y apporta son expérience pastorale, avec sa parole simple et forte, émue parfois. Non seulement il eut à cœur de maintenir les activités mises en place par son prédécesseur, mais il y fonda encore le Cercle Saint-Michel qui devint un centre d’activité catholique. En pleine guerre, c’est encor
jeune Jules reçoit de sa famille les valeurs de travail et d’honorabilité qui s’y transmettaient de génération en génération. Après des études primaires et secondaires au collège de sa ville natale, il entre en 1867 au Grand Séminaire pour en sortir prêtre en 1872. Commence alors pour lui une très longue carrière qui le verra successivement vicaire à Trets, curé de Villeneuve-Gageron, professeur au collège catholique d’Aix, curé d’Alleins, Mallemort et de Saint-Pierre de Trinquetaille. L’importante paroisse de Salon ayant perdu son curé en décembre 1906, l’abbé Berlandier y fut nommé à 60 ans, en 1907, assumant une succession écrasante. Il y apporta son expérience pastorale, avec sa parole simple et forte, émue parfois. Non seulement il eut à cœur de maintenir les activités mises en place par son prédécesseur, mais il y fonda encore le Cercle Saint-Michel qui devint un centre d’activité catholique. En pleine guerre, c’est encor e à lui qu’on pensa pour l’éminente cure de Saint-Trophime d’Arles devenue vacante en 1916. La primatiale (dont il avait été chanoine) trouva en lui un archiprêtre intelligent et un administrateur avisé et volontaire. C’est sous son autorité qu’y furent célébrées en novembre 1926 les somptueuses fêtes consécutives à la béatification de Mgr du Lau, archevêque d’Arles, martyr des massacres de septembre, présidées par le cardinal Charost, archevêque de Rennes. Pour récompenser l’octogénaire archiprêtre, Monseigneur Rivière, archevêque d’Aix, demanda alors pour lui les honneurs de la prélature. Il allait mener sa paroisse dix ans encore : ce n’est qu’en 1935 qu’il demanda l’assistance d’un pro-archiprêtre qui lui fut accordé en la personne du chanoine Viaud, sans pour autant prendre sa retraite. Entouré des soins de son second, Mgr Berlandier déclina rapidement et s’éteint le 26 mai 1939, servi jusqu’au bout par un tempérament robuste et une parfaite lucidité d’esprit. Ses funérailles furent célébrées le lundi de Pentecôte 29 mai, présidées par l’archevêque qui témoigna que le défunt s’était montré prêtre dans toute la force du terme tout au long de sa longue vie sacerdotale. Monseigneur Berlandier fut inhumé le 28 mai dans le caveau familial du cimetière Saint-Lazare, de Tarascon. Il avait été fait chanoine honoraire de Fréjus en 1929 par Mgr Simeone.
e à lui qu’on pensa pour l’éminente cure de Saint-Trophime d’Arles devenue vacante en 1916. La primatiale (dont il avait été chanoine) trouva en lui un archiprêtre intelligent et un administrateur avisé et volontaire. C’est sous son autorité qu’y furent célébrées en novembre 1926 les somptueuses fêtes consécutives à la béatification de Mgr du Lau, archevêque d’Arles, martyr des massacres de septembre, présidées par le cardinal Charost, archevêque de Rennes. Pour récompenser l’octogénaire archiprêtre, Monseigneur Rivière, archevêque d’Aix, demanda alors pour lui les honneurs de la prélature. Il allait mener sa paroisse dix ans encore : ce n’est qu’en 1935 qu’il demanda l’assistance d’un pro-archiprêtre qui lui fut accordé en la personne du chanoine Viaud, sans pour autant prendre sa retraite. Entouré des soins de son second, Mgr Berlandier déclina rapidement et s’éteint le 26 mai 1939, servi jusqu’au bout par un tempérament robuste et une parfaite lucidité d’esprit. Ses funérailles furent célébrées le lundi de Pentecôte 29 mai, présidées par l’archevêque qui témoigna que le défunt s’était montré prêtre dans toute la force du terme tout au long de sa longue vie sacerdotale. Monseigneur Berlandier fut inhumé le 28 mai dans le caveau familial du cimetière Saint-Lazare, de Tarascon. Il avait été fait chanoine honoraire de Fréjus en 1929 par Mgr Simeone.