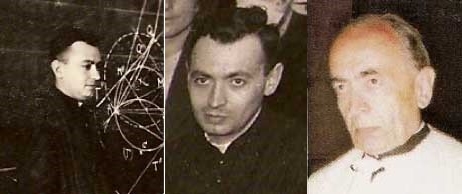Jean Rey (1761-1851)
Le 17 juillet 1761, nait à Solliès-Pont Jean-Alexis Rey, fils de Jacques(-Etienne) Rey, boulanger, et d’Anne Rose Tourel. L’enfant reçoit le baptême le lendemain des mains du vicaire de la paroisse. Ordonné prêtre dans les années 1780, l’abbé Rey est économe du grand séminaire de Fréjus où il est aussi directeur quand éclate la Révolution française. A la suite du supérieur du séminaire, l’abbé Audibert (repenti, il couchera des années en pénitence sur des sarments et mourra aumônier de l’hôpital de Draguignan en 1806), le jeune abbé prête serment et accepte même en 1792 la cure de Fréjus des mains de Jean-Joseph Rigouard, élu « évêque constitutionnel » du Var l’année précédente. A cette époque quelques prêtres courageux se battent au péril de leur vie pour exercer le ministère au nom de Mgr de Bausset en exil, comme le vaillant curé de Puget-sur-Argens, l’abbé Henri-Antoine Chiris (1736-1804). C’est pourtant lui qui fera un des premiers gestes en direction de l’abbé Rey au lendemain de la Révolution : ayant restauré le culte dans sa paroisse avant même le Concordat, il l’invita à venir prêcher la première communion à Puget en 1802. Revenu de ses erreurs, l’abbé Rey fut nommé vicaire de Roquebrune auprès d’un des frères prêtres* d’Henri-Antoine, l’abbé Jean-Jospeh Chiris (1747-1804), recteur de Roquebrune-sur-Argens. Il lui succéda ensuite comme curé. Le 3 août 1823, l’ancien curé constitutionnel de la cathédrale de Fréjus est témoin de la prise de possession du siège restauré de Fréjus par Mgr de Richery, opérée en son nom par l’abbé André Saurin ; celui-ci, professeur de philosophie et de théologie dogmatique au séminaire avant la Révolution, avait été le confrère de l’abbé Rey avant de prendre le parti opposé. On imagine les sentiments contrastés qui devaient l’habiter alors, et la prudence qu’aura à son égard le nouvel évêque réputé très réactionnaire… En 1836, ce sera Mgr Michel qui lui accordera une stalle au chapitre cathédral en qualité de chanoine titulaire. Il y occupera la charge de théologal. Le chanoine Rey meurt à Fréjus un 21 janvier (anniversaire de la décapitation de Louis XVI…). C’était en 1851. A près de 90 ans, le chanoine Rey avait connu pas moins de six régimes qui s’étaient succédé à la tête de la France et pouvait se dire que sa propre fidélité était aussi le fruit de la miséricorde.
* Ils avaient un frère aîné, prêtre lui aussi : Jean-Esprit Chiris (1734-1805).


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.


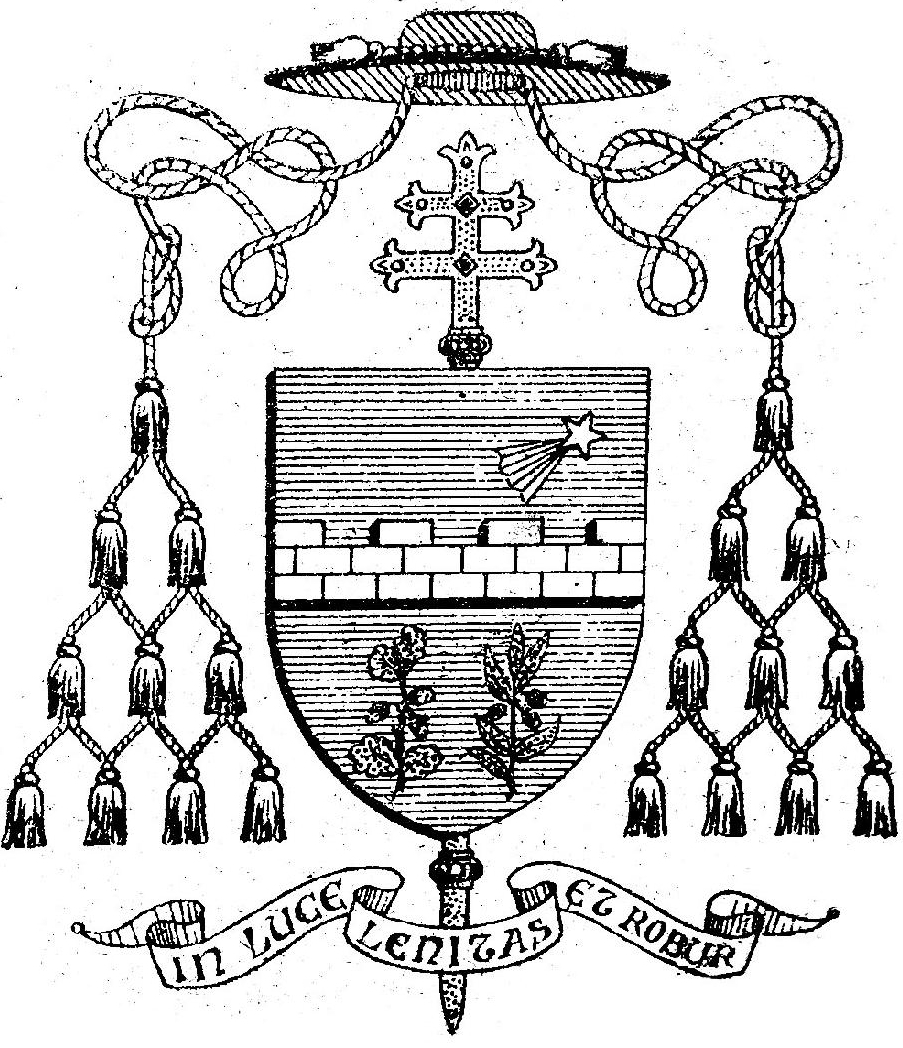 r 1926 et lui succède le 5 avril 1930. Le 28 juillet 1931, il est transféré au siège archiépiscopal d’Aix pour succéder à Mgr Rivière. L’enseignement, les vocations sacerdotales, le catéchisme, l’Action catholique furent ses préoccupations dominantes. Il meurt brutalement le 18 janvier 1934. Il est inhumé dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Mgr Coste avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1933.
r 1926 et lui succède le 5 avril 1930. Le 28 juillet 1931, il est transféré au siège archiépiscopal d’Aix pour succéder à Mgr Rivière. L’enseignement, les vocations sacerdotales, le catéchisme, l’Action catholique furent ses préoccupations dominantes. Il meurt brutalement le 18 janvier 1934. Il est inhumé dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Mgr Coste avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1933.
 Maurice-Louis-Marie Rivière nait à Paris le 6 juin 1859 et reçoit le baptême dans l’église Notre-Dame-des-Victoires. Son père est administrateur du Crédit Foncier et architecte de la ville de Paris, sa mère est sœur de Georges Gamard, conseiller municipal de Paris et député de la Mayenne qui est encore l’oncle du cardinal Richard. Maurice est l’aîné de six enfants dont l’un, Pierre, sera curé de Saint-Thomas-d’Aquin. Après avoir fait ses études au collège Stanislas, il passa six ans à Rome au Séminaire français d’où il revint avec le grade de docteur en philosophie. Ordonné prêtre le 8 avril 1882 en la cathédrale Saint-Jean-de-Latran, l’abbé Maurice Rivière pense se consacrer aux Missions étrangères et séjourne trois mois rue du Bac au siège de la Société. Finalement il demande au cardinal Guibert une place dans le diocèse de Paris. L’archevêque qui a vite jugé le candidat l’affecte d’abord comme vicaire à la Madeleine puisqu’ « il convient d’être novice là où l’on doit être profès ». Pendant quinze ans il s’y dépensa dans un apostolat laborieux et fécond. En 1898, il est nommé curé de Saint-Antoine des Quinze-Vingt où il construisit la nouvelle église puis, finalement, de la Madeleine. Il remplit sa mission avec zèle notamment dans les heures tragiques du début de la guerre. Le 1er juin 1915, Benoît XV le choisit comme évêque de Périgueux, il est sacré le 21 septembre. Cinq ans plus tard, le 9 juillet 1920, il est transféré au siège archiépiscopal d’Aix en remplacement de Mgr Bonnefoy. Comme son prédécesseur, il recevra le titre de chanoine d’honneur de Fréjus, en 1922.
Maurice-Louis-Marie Rivière nait à Paris le 6 juin 1859 et reçoit le baptême dans l’église Notre-Dame-des-Victoires. Son père est administrateur du Crédit Foncier et architecte de la ville de Paris, sa mère est sœur de Georges Gamard, conseiller municipal de Paris et député de la Mayenne qui est encore l’oncle du cardinal Richard. Maurice est l’aîné de six enfants dont l’un, Pierre, sera curé de Saint-Thomas-d’Aquin. Après avoir fait ses études au collège Stanislas, il passa six ans à Rome au Séminaire français d’où il revint avec le grade de docteur en philosophie. Ordonné prêtre le 8 avril 1882 en la cathédrale Saint-Jean-de-Latran, l’abbé Maurice Rivière pense se consacrer aux Missions étrangères et séjourne trois mois rue du Bac au siège de la Société. Finalement il demande au cardinal Guibert une place dans le diocèse de Paris. L’archevêque qui a vite jugé le candidat l’affecte d’abord comme vicaire à la Madeleine puisqu’ « il convient d’être novice là où l’on doit être profès ». Pendant quinze ans il s’y dépensa dans un apostolat laborieux et fécond. En 1898, il est nommé curé de Saint-Antoine des Quinze-Vingt où il construisit la nouvelle église puis, finalement, de la Madeleine. Il remplit sa mission avec zèle notamment dans les heures tragiques du début de la guerre. Le 1er juin 1915, Benoît XV le choisit comme évêque de Périgueux, il est sacré le 21 septembre. Cinq ans plus tard, le 9 juillet 1920, il est transféré au siège archiépiscopal d’Aix en remplacement de Mgr Bonnefoy. Comme son prédécesseur, il recevra le titre de chanoine d’honneur de Fréjus, en 1922.  Très bon, notamment avec ses prêtres, il sut aussi gouverner avec l’autorité dont il était investi. C’est sous son épiscopat qu’eut lieu l’affaire de l’Action Française, condamnée par le pape Pie XI, qui ne manqua pas d’intéresser le diocèse d’Aix où le jeune Maurras avait passé toute son enfance sous la férule d’ecclésiastiques éminents (on se souvient que Mgr Guillibert l’avait eu pour élève). Lors de sa visite ad limina en octobre 1926, Mgr Rivière osera plaider la cause de l’Action Française, porteur d’un dossier dont on se rendit compte qu’il avait été visiblement fourni par Maurras lui-même. L’accueil du pape fut glacial et l’archevêque sortit marri de l’audience. Fin janvier 1929, l’autorité romaine veillant, Mgr Rivière se voit contraint d’interdire les funérailles d’un conseiller municipal de Barbentane, fervent catholique, membre de l’Action Française ; en l’absence de prêtre, deux mille personnes pénètrent dans l’église et accompagnent le défunt en chantant les prières des morts, l’archevêque jette alors l’interdit sur la paroisse le 24 janvier, qu’il ne lèvera que le 5 février après la soumission des notables de la ville, et recevant cette fois la bénédiction de Pie XI qui avait suivi l’affaire par le biais de la nonciature… L’archevêque mourut l’année suivante au château du Vast (Manche), le 28 septembre 1930, après des semaines de maladie, non sans avoir échangé avec le pape jusqu’à la fin d’émouvants sentiments de communion totale à l’approche de la mort. Il fut inhumé dans sa cathédrale le mardi 7 octobre 1930.
Très bon, notamment avec ses prêtres, il sut aussi gouverner avec l’autorité dont il était investi. C’est sous son épiscopat qu’eut lieu l’affaire de l’Action Française, condamnée par le pape Pie XI, qui ne manqua pas d’intéresser le diocèse d’Aix où le jeune Maurras avait passé toute son enfance sous la férule d’ecclésiastiques éminents (on se souvient que Mgr Guillibert l’avait eu pour élève). Lors de sa visite ad limina en octobre 1926, Mgr Rivière osera plaider la cause de l’Action Française, porteur d’un dossier dont on se rendit compte qu’il avait été visiblement fourni par Maurras lui-même. L’accueil du pape fut glacial et l’archevêque sortit marri de l’audience. Fin janvier 1929, l’autorité romaine veillant, Mgr Rivière se voit contraint d’interdire les funérailles d’un conseiller municipal de Barbentane, fervent catholique, membre de l’Action Française ; en l’absence de prêtre, deux mille personnes pénètrent dans l’église et accompagnent le défunt en chantant les prières des morts, l’archevêque jette alors l’interdit sur la paroisse le 24 janvier, qu’il ne lèvera que le 5 février après la soumission des notables de la ville, et recevant cette fois la bénédiction de Pie XI qui avait suivi l’affaire par le biais de la nonciature… L’archevêque mourut l’année suivante au château du Vast (Manche), le 28 septembre 1930, après des semaines de maladie, non sans avoir échangé avec le pape jusqu’à la fin d’émouvants sentiments de communion totale à l’approche de la mort. Il fut inhumé dans sa cathédrale le mardi 7 octobre 1930. Adrien-Sébastien-Marius Bouvet, fils d’Antoine, Commis Principal des contributions indirectes naît le 12 mars 1910 à Embrun où il fait ses premières classes au collège de la ville. Son père est muté à Toulon en 1920 et Adrien, âgé de 10 ans, entre à l'Externat Saint-Joseph tenu par les Pères Maristes à Toulon. Il y restera de 1920 à 1923. C'est son premier contact avec la Société de Marie. Une nouvelle mutation éloigne la famille mais le jeune Adrien est mis en pension à l'Internat Sainte-Marie de La Seyne. Il y fera, de 1923 à 1926, de brillantes études avec de nombreux premiers prix en particulier en mathématiques, physique et chimie, allemand. A 16 ans et 4 mois, il a son baccalauréat en poche avec mention assez bien. Il entre au noviciat mariste le 31 octobre 1926 et fait profession temporaire le 1er novembre 1927. Après des études en Belgique puis à Lyon, il part pour Rome où il est inscrit à l’Angelicum. Il est ordonné prêtre le 15 avril 1933 à la cathédrale Saint-Jean-de-Latran. Il fortifiera à Rome son grand amour de l'Eglise et son attachement indéfectible au Saint-Père. C'est nanti d'une licence ès-sciences physiques et d'une licence de théologie, alors qu'il n'est qu'à quelques mois d'en obtenir le doctorat, que son ordre (sur les conseils du père Graly qui avait remarqué cet élève hors du commun) le rappelle à La Seyne pour enseigner en classe de mathématiques élémentaires alors qu’il a 24 ans. Sept ans plus tard, il devient supérieur du collège en 1941 et le restera jusqu’en 1949. En 1943 l’institution doit fermer ses portes mais le Père Bouvet reste supérieur sous l'occupation italienne puis allemande. Sa maîtrise parfaite de l'italien et son aisance en allemand lui permettront de jouer les médiateurs : parmi les quelques témoignages on rapporte comment il a fourni des vêtements civils à des militaires français prisonniers à l'externat Saint-Joseph de Toulon pour rejoindre la France libre, et comment, en parlementant avec le Chef du détachement allemand, il évita le peloton d'exécution à un prisonnier lors de l'attaque du poste de police le 21 août 1944. Pendant ce temps, il accompagne inlassablement les nombreuses familles endeuillées à la suite des bombardements successifs, transformant le bâtiment des classes et les cours en chapelles ardentes. C’est en 1949, lors du centenaire du collège, que Monseigneur Gaudel annonce que « si les règles de la Société de Marie ne s'y opposent pas, il était heureux de faire chanoine honoraire de sa cathédrale de Fréjus » le Père Bouvet. De 1950 à 1953, il est supérieur du collège de Montluçon avant d’être élu provincial en 1953. En 1959, renonçant à une carrière plus brillante (un poste offert à la congrégation de la Propagation de la foi), il fait humblement le choix de revenir à l'enseignement, à sa famille, à sa ville, et à son Midi : pendant dix-sept ans ans, il sera préfet des classes à l'externat Saint-Joseph, sous des supérieurs dont il avait été le provincial (même s'il assume aux regards de l'administration la fonction de directeur administratif). Il prend sa retraite à Sainte-Marie en 1976 et s'éteint à La Castille le 16 août 1989.
Adrien-Sébastien-Marius Bouvet, fils d’Antoine, Commis Principal des contributions indirectes naît le 12 mars 1910 à Embrun où il fait ses premières classes au collège de la ville. Son père est muté à Toulon en 1920 et Adrien, âgé de 10 ans, entre à l'Externat Saint-Joseph tenu par les Pères Maristes à Toulon. Il y restera de 1920 à 1923. C'est son premier contact avec la Société de Marie. Une nouvelle mutation éloigne la famille mais le jeune Adrien est mis en pension à l'Internat Sainte-Marie de La Seyne. Il y fera, de 1923 à 1926, de brillantes études avec de nombreux premiers prix en particulier en mathématiques, physique et chimie, allemand. A 16 ans et 4 mois, il a son baccalauréat en poche avec mention assez bien. Il entre au noviciat mariste le 31 octobre 1926 et fait profession temporaire le 1er novembre 1927. Après des études en Belgique puis à Lyon, il part pour Rome où il est inscrit à l’Angelicum. Il est ordonné prêtre le 15 avril 1933 à la cathédrale Saint-Jean-de-Latran. Il fortifiera à Rome son grand amour de l'Eglise et son attachement indéfectible au Saint-Père. C'est nanti d'une licence ès-sciences physiques et d'une licence de théologie, alors qu'il n'est qu'à quelques mois d'en obtenir le doctorat, que son ordre (sur les conseils du père Graly qui avait remarqué cet élève hors du commun) le rappelle à La Seyne pour enseigner en classe de mathématiques élémentaires alors qu’il a 24 ans. Sept ans plus tard, il devient supérieur du collège en 1941 et le restera jusqu’en 1949. En 1943 l’institution doit fermer ses portes mais le Père Bouvet reste supérieur sous l'occupation italienne puis allemande. Sa maîtrise parfaite de l'italien et son aisance en allemand lui permettront de jouer les médiateurs : parmi les quelques témoignages on rapporte comment il a fourni des vêtements civils à des militaires français prisonniers à l'externat Saint-Joseph de Toulon pour rejoindre la France libre, et comment, en parlementant avec le Chef du détachement allemand, il évita le peloton d'exécution à un prisonnier lors de l'attaque du poste de police le 21 août 1944. Pendant ce temps, il accompagne inlassablement les nombreuses familles endeuillées à la suite des bombardements successifs, transformant le bâtiment des classes et les cours en chapelles ardentes. C’est en 1949, lors du centenaire du collège, que Monseigneur Gaudel annonce que « si les règles de la Société de Marie ne s'y opposent pas, il était heureux de faire chanoine honoraire de sa cathédrale de Fréjus » le Père Bouvet. De 1950 à 1953, il est supérieur du collège de Montluçon avant d’être élu provincial en 1953. En 1959, renonçant à une carrière plus brillante (un poste offert à la congrégation de la Propagation de la foi), il fait humblement le choix de revenir à l'enseignement, à sa famille, à sa ville, et à son Midi : pendant dix-sept ans ans, il sera préfet des classes à l'externat Saint-Joseph, sous des supérieurs dont il avait été le provincial (même s'il assume aux regards de l'administration la fonction de directeur administratif). Il prend sa retraite à Sainte-Marie en 1976 et s'éteint à La Castille le 16 août 1989.