Louis Baliste (1771-1794)
Le chanoine Baliste, un des derniers chanoines à intégrer le chapitre de Fréjus à la veille de la Révolution reste très mystérieux : le peu de temps qu’il occupa sa stalle et la carence des registres d’insinuations ecclésiastiques pour la période nous contraignent à des conjectures.
C’est dans les listes publiées par La France ecclésiastique à partir de 1787 qu’apparaît le chanoine Baliste à la stalle de capiscol de Fréjus.
La fonction était jusque-là occupée par le chanoine Charles Gavoty, au moins jusqu’en octobre 1785, qui l’avait visiblement abandonnée avant février 1786 ; ses bénéfices parisiens suffisant largement à ses besoins, messire Gavoty qui avait élu domicile dans la capitale avait dû, selon l’usage, résigner sa stalle fréjussienne à un proche : tant d’autres avaient ainsi désigné un neveu pour recueillir une prébende qu’on laissait rarement échapper à un tiers.
L’abbé Baliste est donc à rechercher parmi ses parents. De 1695 à 1785, plusieurs mariages avaient uni les Gavoty aux Baliste, établis depuis des siècles au Luc. Cardeurs de laine, tanneurs, marchands drapiers, négociants, les membres de la famille s’étaient progressivement élevés au premier rang de la société locale. Ainsi le 29 avril 1739 au Luc, l’abbé Gavoty pas encore promu aux ordres majeurs, assiste-t-il au mariage de sa sœur, Thérèse avec Etienne Baliste qui finira procureur du bailliage. Le couple aura deux enfants :
- Thérèse-Rossoline Baliste dont l’abbé Gavoty sera le parrain en 1752, et qui épousera Louis-Michel Roman : ils seront les arrière-grands-parents de l’abbé Charles-Marie-Thérèse-Laurent-François Roman (1844-1911), et les arrière-arrière-grands-parents du Père Lucien Charles Auguste Roman, missionnaire (1879-1945),
- et Joseph-Etienne Baliste (1744-1817), greffier, directeur de la poste, procureur du bailliage qui, de son épouse Anne-Marguerite Sarrasin, aura dix enfants parmi lesquels Louis (Louis-Jacques-Etienne), né au Luc le 1er mai 1771. Le jeune homme a donc tout juste quinze ans quand son grand-oncle lui abandonne probablement sa stalle de chanoine vers 1786. Les décrets du concile de Trente exigeant que les nouveaux chanoines aient déjà été admis aux ordres majeurs et qu’ils aient donc au moins 21 ou 22 ans n’ayant pas été reçus en France, les clercs minorés destinés au canonicat sont cependant tenus de poursuivre leurs études ecclésiastiques pour correspondre dès que possible aux exigences canoniques qui restent une référence à laquelle on tente de se conformer.
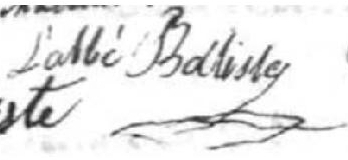 Le jeune promu n’atteindra les 21 ans qu’en 1792. C’est à cette date que l’ « abbé » Louis Baliste apparait encore comme simple ecclésiastique au baptême de sa filleule Louise Clérian le 13 juillet de cette année, en l’église du Luc. Mais la Révolution avait depuis anéanti le chapitre et sans doute aussi les espérances du ci-devant capiscol qui ne parviendra visiblement pas au sacerdoce : il meurt en effet dans la maison paternelle du Luc le 21 floréal an II, soit le 10 mai 1794 à seulement 23 ans…
Le jeune promu n’atteindra les 21 ans qu’en 1792. C’est à cette date que l’ « abbé » Louis Baliste apparait encore comme simple ecclésiastique au baptême de sa filleule Louise Clérian le 13 juillet de cette année, en l’église du Luc. Mais la Révolution avait depuis anéanti le chapitre et sans doute aussi les espérances du ci-devant capiscol qui ne parviendra visiblement pas au sacerdoce : il meurt en effet dans la maison paternelle du Luc le 21 floréal an II, soit le 10 mai 1794 à seulement 23 ans…


 La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».
La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».
