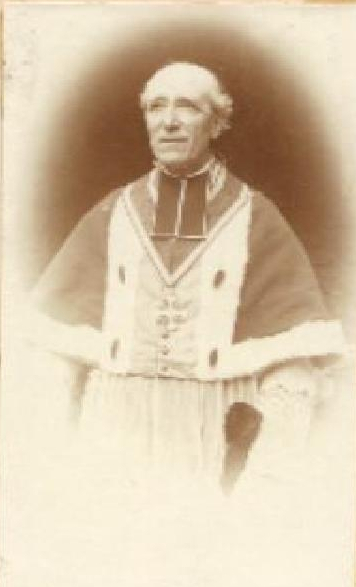Charles Dauphin (1850-1938)
Charles-Théodore Dauphin naît à Régusse le 11 janvier 1850, fils de Louis Dauphin, marchand, et de Marie-Anne-Désirée Ambrois. L’appel de Dieu se fit sentir très tôt dans le cœur de l’enfant qui commença au lendemain de sa première communion, le jour de l’Ascension, 22 mai 1862, l’étude du latin auprès de son curé, l’abbé Bonnet. En octobre 1864, il entrait au Petit séminaire de Brignoles en classe de quatrième sous la férule du jeune abbé Calixte Blanc, le futur chanoine et vicaire général. Avec onze autres camarades (trois de son cours dont les futurs chanoines Grisolle et Léocard), il prend la soutane le 2 février 1866, ayant bien conscience de dire déjà « adieu au monde » par cette cérémonie. Le jeune clerc poursuit sa formation au Grand séminaire de Fréjus où il entre en 1868. Se succèdent la tonsure le 22 mai 1869, les ordres mineurs le 8 avril 1871, le sous-diaconat le 25 juin 1871, le diaconat le 25 mai 1872 et enfin l’ordination sacerdotale le 25 mai 1873. Viennent alors les premières nominations ; c’est le jour de la Fête-Dieu, 12 juin 1873, que le nouveau prêtre fit connaissance avec sa première paroisse, de l’archiprêtré de Grasse : Briançonnet, village de quelques centaines d’âmes assez ferventes pour que le nouveau curé y établisse une congrégation dédiée à sainte Anne ainsi qu’une association de la Bonne Mort et rebâtisse la chapelle Saint-Pierre au sommet de la montagne, qu’il aura le bonheur de bénir le dimanche 27 juin 1875. Cette année jubilaire vit encore la paroisse bénéficier d’une mission au terme de laquelle une croix fut érigée à l’entrée du village. Comme son prédécesseur le chanoine Victorin Aune, l’abbé Dauphin quitta Briançonnet après trois années heureuses, pour la florissante paroisse de la Cadière où il arriva comme vicaire en juin 1876. Au bout de trois ans, le nouvel évêque, Mgr Terris, procéda à un nouveau transfert et c’est aux Arcs que le vicaire dut s’installer en juillet 1879, sous la responsabilité du chanoine Disdier bientôt remplacé, après sa mort prématurée, par le chanoine Antoine Giraud. L’abbé Dauphin y resta jusqu’en juillet 1885. Ebranlé par plusieurs deuils, sa santé s’était dégradée et l’obligea à demander un congé : avec sa mère qui l’avait accompagné dans ses ministères successifs, il se retira alors à Régusse, sans affectation particulière. Dès le mois d’octobre de la même année, l’abbé Dauphin était en mesure d’accepter le poste de curé de Tourrettes où il s’essaya avec succès à prêcher en provençal. En juillet 1886, nommé curé de Montfort, il y passe quatre années quelque peu agitées par les mouvements politiques auxquels étaient sensibles les communes du centre Var, une nouvelle paroisse fut alors désignée à l’ab bé Dauphin : le village de Belgentier. L’humidité du presbytère étant préjudiciable à la santé de sa mère, qui se dégrada alors, il dut demander un nouveau changement l’année suivante, ce fut donc à Flassans qu’il exerça son ministère curial au cours de la dernière décennie du XIXème siècle. C'est là que mourra sa mère, le 4 décembre 1898. De 1902 à 1905, l’abbé Dauphin sera ensuite attaché à l’orphelinat de Boulouris comme aumônier, ce qui lui laissera assez de loisir pour commencer la rédaction de ses mémoires. Il sera ensuite appelé à devenir curé doyen d’Aups où il reste de 1907 à 1912. C’est cette dernière année que Mgr Guillibert le promeut chanoine titulaire de sa cathédrale. Messire Dauphin rejoint alors Fréjus où il passe les quinze dernières années de sa vie. C’est là qu’il achève la rédaction de ses souvenirs, en 1936. Le 23 décembre 1919, il reçoit la fonction de chanoine pénitencier. Il meurt dans la cité épiscopale le 12 mars 1938. Il est inhumé le 14 dans le carré des chanoines, autour de la croix du vieux cimetière Saint-Léonce.
bé Dauphin : le village de Belgentier. L’humidité du presbytère étant préjudiciable à la santé de sa mère, qui se dégrada alors, il dut demander un nouveau changement l’année suivante, ce fut donc à Flassans qu’il exerça son ministère curial au cours de la dernière décennie du XIXème siècle. C'est là que mourra sa mère, le 4 décembre 1898. De 1902 à 1905, l’abbé Dauphin sera ensuite attaché à l’orphelinat de Boulouris comme aumônier, ce qui lui laissera assez de loisir pour commencer la rédaction de ses mémoires. Il sera ensuite appelé à devenir curé doyen d’Aups où il reste de 1907 à 1912. C’est cette dernière année que Mgr Guillibert le promeut chanoine titulaire de sa cathédrale. Messire Dauphin rejoint alors Fréjus où il passe les quinze dernières années de sa vie. C’est là qu’il achève la rédaction de ses souvenirs, en 1936. Le 23 décembre 1919, il reçoit la fonction de chanoine pénitencier. Il meurt dans la cité épiscopale le 12 mars 1938. Il est inhumé le 14 dans le carré des chanoines, autour de la croix du vieux cimetière Saint-Léonce.
(avec reconnaissance à Mme Virginie Quentrec, petite-nièce du chanoine, qui nous a communiqué la copie du manuscrit de ses mémoires ainsi que sa photographie)


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.