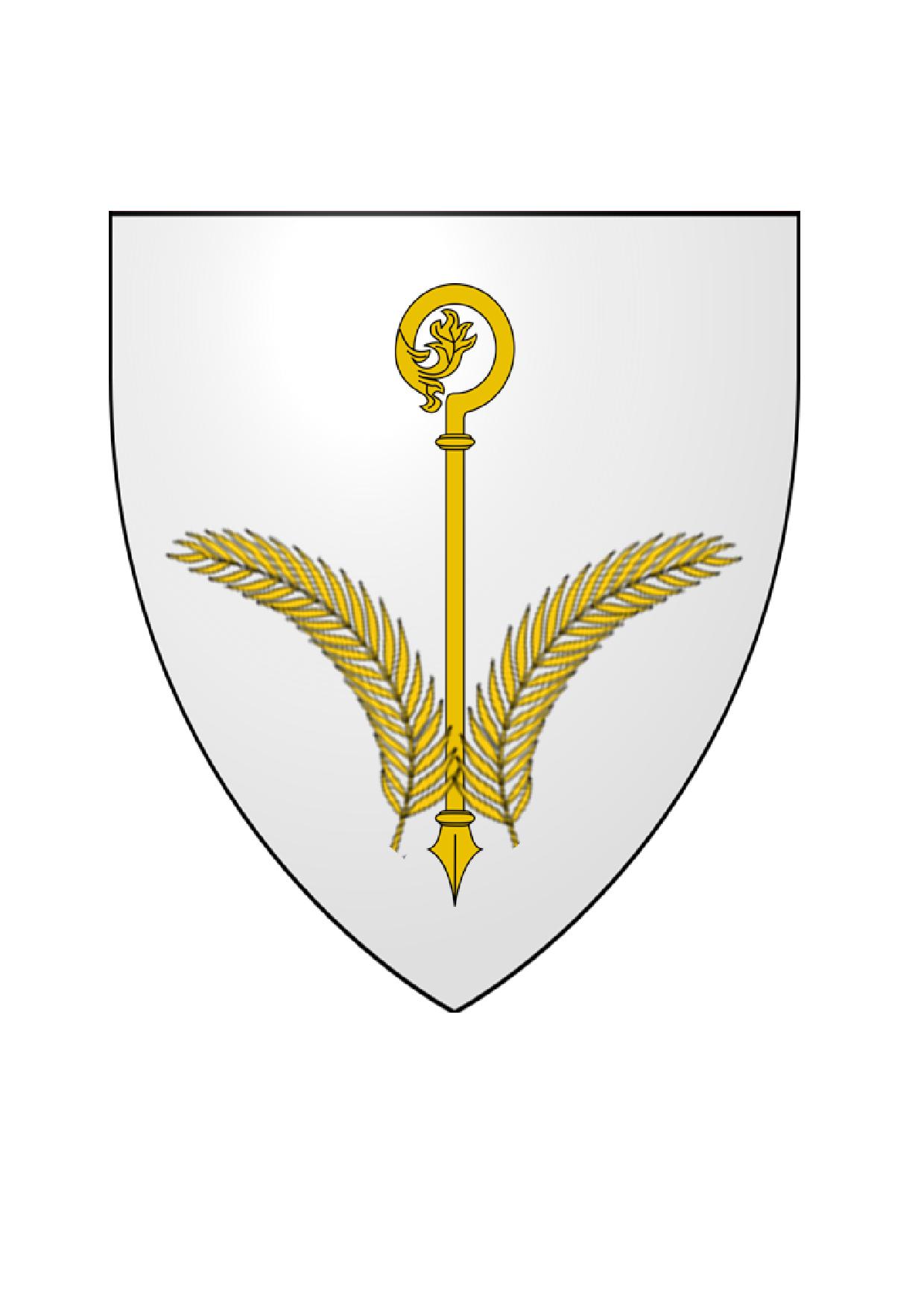
Rme Père Marie-André Drilhon (1880-1963), chanoine d'honneur
Né à Angoulême le 2 septembre 1880, Edmond Drilhon est le quatrième d’une fratrie de dix enfants. Il entre au séminaire diocésain et reçoit l’ordination sacerdotale le 24 juin 1904. Il est d’abord vicaire à Barbezieux, puis curé de Criteuil à partir de 1906 et en 1911 de Saint-Séverin, paroisses de son diocèse natal. Lorsque la Grande Guerre éclate, il est aumônier volontaire du 107° de ligne et se distingue par son courage et son dévouement. Outre la médaille militaire, il en reçut quatre citations flatteuses. De retour dans sa paroisse, il pense à la vie contemplative et entre au monastère de Lérins en octobre 1922. Il y fait profession le 25 novembre 1923. Celui qu’on appelle désormais le Père Marie-André devient par la suite prieur et maître des novices. La veille des Rameaux 1928, le révérendissime Abbé Général de La Commune Observance de Cîteaux arrive au monastère pour y faire la visite canonique. Emu du grand âge et de l’affaiblissement du Père Abbé, Dom Léonce Granet, il lui propose de donner sa démission, ce qu’il accueille avec soulagement. Immédiatement, au cours de la Semaine Sainte, on procède à l’élection du Père Marie-André sous la direction du Père Abbé Général qui lui donne la bénédiction abbatiale le jour de Pâques, 8 avril 1928, en présence de l’abbé de Saint-Michel de Prades. Mgr Simeone, évidemment retenu à cette date, lui accorda le titre de chanoine d’honneur de son chapitre, la même année. Le Très Révérend Père Marie-André gouverna son abbaye jusqu’en 1937. Le 14 octobre 1928, la consécration solennelle de l’église abbatiale fut l’occasion de célébrer avec faste la vitalité retrouvée de la communauté qui venait d’envoyer un petit contingent de moines relever l’abbaye de Sénanque. Pendant son fructueux abbatiat, Dom Marie-André fonda en 1932 la maison de Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, au Québec, qui sera érigée en abbaye en 1950, et en 1934 le prieuré de Notre-Dame du Sacré-Cœur de My Ca, au Vietnam. En avril 1937, le Très Révérend Père Marie-André dépose sa charge et rejoint le monastère du Pont-Colbert, près de Versailles, puis celui de Saint-Michel-de-Cuxa où il meurt le 29 décembre 1963. Il est inhumé dans la crypte de l'abbaye pyrénéenne.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
