Jules-Léonce Coste (1752-1802)
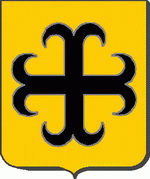 La liste des émigrés de la Révolution française fait état d’un Jean-Léonce Coste « ex-chanoine », enregistré le 22 vendémiaire an III (13 octobre 1794). Le 25 février 1793, elle évoquait un autre prêtre du même nom ayant quitté la France : l’abbé Jules-Léonce Coste. Il semble qu’il y ait eu confusion entre l’oncle et le neveu.
La liste des émigrés de la Révolution française fait état d’un Jean-Léonce Coste « ex-chanoine », enregistré le 22 vendémiaire an III (13 octobre 1794). Le 25 février 1793, elle évoquait un autre prêtre du même nom ayant quitté la France : l’abbé Jules-Léonce Coste. Il semble qu’il y ait eu confusion entre l’oncle et le neveu.
Léonce-Jules-Thomas (ou Jules-Léonce) Coste était né à Fréjus le 21 décembre 1752, fils de Maître Antoine Coste (1715-1764), avocat en la cour, commisaire des classes au département de Fréjus et juge de cette ville, et de Jeanne de Ferrier (petite-nièce du chanoine Antoine Merle). Son ascendance est illustrée par une lignée de notaires : Jean-François Coste (1675-1742), son grand-père ou Emmanuel (ca 1636-1706), son arrière grand-père. C’est le chanoine théologal Jules-Léonce Cavalier en personne qui le baptise dans la cathédrale de Fréjus et lui donne le prénom qui lui restera, étant en même temps son parrain. Cette famille de notables cultivait les liens avec le chapitre : ce furent par exemple les parents du chanoine Suffret qui avaient été parrain et marraine de sa tante Rosolline Coste, en 1705.
Messire Léonce Jules Coste, prêtre, n'est encore que professeur au séminaire de Fréjus quand il assiste au mariage de sa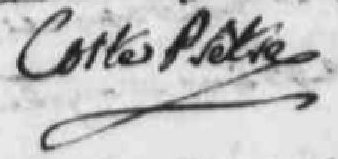 soeur Marie Anne le 6 novembre 1781 dans la cathédrale. Il semble qu'il intégra le chapitre peu de temps après, moins de cinq avant la Révolution toutefois, avec la prébende Sainte-Madeleine d'Espérel. Il fut le dernier à résigner sa stalle avant la suppression du chapitre, en décembre 1789, au profit de Jean-Joseph Audibert qui en prit possession le 29 décembre 1789. En juin 1792, le ci-devant chanoine gagne Gênes. Le Père Augustin Theiner, dans ses Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France 1790 à 1800, (1858), note que ce Giles (sic) Coste, qu’il qualifie de chanoine et – à tort – de supérieur du séminaire de Fréjus, a été réfugié chez les capucins de Genzano avant de gagner Rome. L’abbé Aimé Guillon, quant à lui, dans son ouvrage intitulé Les martyrs de la foi pendant la Révolution française, paru en 1821, évoque l’abbé Coste, chanoine de Fréjus, qui en exil aurait collaboré à la traduction et à la publication avec l’abbé de Rey, chanoine de Montpellier, du livre de leur ami commun, l’abbé Giovanni Marchetti (futur archevêque d’Ancyre) Ch’importa a’Preti, réaffirmant les droits du souverain pontife, sous le titre Qu’importe aux Prêtres ? ou L’intérêt de la religion chrétienne dans les grands événements politiques de nos jours : Réflexions morales d’un ami de tous, à un de ses amis, publié à Rome en 1797. Le chanoine Jules-Léonce serait mort à Rome le 23 février 1802.
soeur Marie Anne le 6 novembre 1781 dans la cathédrale. Il semble qu'il intégra le chapitre peu de temps après, moins de cinq avant la Révolution toutefois, avec la prébende Sainte-Madeleine d'Espérel. Il fut le dernier à résigner sa stalle avant la suppression du chapitre, en décembre 1789, au profit de Jean-Joseph Audibert qui en prit possession le 29 décembre 1789. En juin 1792, le ci-devant chanoine gagne Gênes. Le Père Augustin Theiner, dans ses Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France 1790 à 1800, (1858), note que ce Giles (sic) Coste, qu’il qualifie de chanoine et – à tort – de supérieur du séminaire de Fréjus, a été réfugié chez les capucins de Genzano avant de gagner Rome. L’abbé Aimé Guillon, quant à lui, dans son ouvrage intitulé Les martyrs de la foi pendant la Révolution française, paru en 1821, évoque l’abbé Coste, chanoine de Fréjus, qui en exil aurait collaboré à la traduction et à la publication avec l’abbé de Rey, chanoine de Montpellier, du livre de leur ami commun, l’abbé Giovanni Marchetti (futur archevêque d’Ancyre) Ch’importa a’Preti, réaffirmant les droits du souverain pontife, sous le titre Qu’importe aux Prêtres ? ou L’intérêt de la religion chrétienne dans les grands événements politiques de nos jours : Réflexions morales d’un ami de tous, à un de ses amis, publié à Rome en 1797. Le chanoine Jules-Léonce serait mort à Rome le 23 février 1802.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
